Brillant auteur de polars maintes fois récompensé, le Japonais Keigo Higashino, né en 1958 à Osaka, ne s’interdit pas d’explorer d’autres territoires. Dans « Le Gardien du camphrier », pas de meurtre, pas de cadavre, mais du mystère et de l’étrangeté à foison. Et des secrets de famille douloureux qui, à la faveur d’un événement inopiné, resurgissent au grand jour et bouleversent la destinée des personnages.
Héro de ce roman au parfum d’initiation, Reito Naoi n’a pas eu de chance. Né d’une liaison de sa mère avec un homme marié, devenu très jeune orphelin, élevé par sa grand-mère, il survit grâce à de petits boulots quand, à la suite d’un délit commis pour se venger d’une injustice, il se retrouve aux portes de la prison. C’est alors qu’intervint une tante dont il ignorait jusque-là l’existence. Elle lui propose d’arranger son affaire en échange d’un service. Il n’a rien à perdre, il accepte.
C’est ainsi que Reito Naoi devient le gardien officiel d’un vieux camphrier situé au cœur du sanctuaire Tsukisato. Mesurant quelque cinq mètres de diamètre et plus de dix mètres de haut, cet arbre centenaire est capable, selon la légende, d’exaucer les vœux et de se faire le messager des défunts. Il présente, sur son flanc, un trou dans lequel les visiteurs viennent se glisser pour prier et accomplir un rituel bien précis. Reito Naoi est chargé de les accueillir, de leur fournir des bougies et de les accompagner sur les lieux.
En quoi consiste le rituel? Il l’ignore, et sa tante refuse de le lui dévoiler. Alors qu’il aide une jeune fille déboussolée à enquêter sur le troublant comportement de son père, un habitué des lieux, Reito Naoi va peu à peu découvrir les secrets du camphrier tout en élucidant les énigmes entourant sa propre existence. Un roman aux allures de parabole, à la fois sobre et poétique et qui, comme souvent chez l’auteur, explore la terrible souffrance liée aux fractures béantes laissées dans l’existence par les tabous et les non-dits. Bref du très bon Higashino, à condition d’accepter de lâcher prise et d’oublier un temps la raison pour s’envoler sur les ailes de l’imaginaire et embrasser ainsi tout l’infini des possibles.
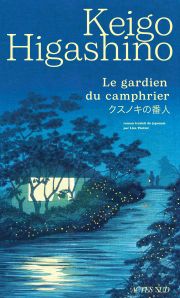 « Le Gardien du camphrier ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Liza Thetiot. Actes Sud, 366 p.
« Le Gardien du camphrier ». De Keigo Higashino. Traduit du japonais par Liza Thetiot. Actes Sud, 366 p.
Sur un autre roman de Keigo Higashino: https://polarspolisetcie.com/keigo-higashino-eclaire-les-secrets-de-famille/
Brillant auteur de polars maintes fois récompensé, le Japonais Keigo Higashino, né en 1958 à Osaka, ne s’interdit pas d’explorer d’autres territoires. Dans « Le Gardien du camphrier », pas de meurtre, pas de cadavre, mais du mystère et de l’étrangeté à foison. Et des secrets de famille douloureux qui, à la faveur d’un événement inopiné, resurgissent […]
Les romans de Louise Penny sont plutôt replets. Ils oscillent en général entre 400 et 500 pages, des pavés donc, mais toujours intelligents, captivants et digestes. Petit cadeau de fin d’année, « Le Pendu », lui, compte moins de cent pages. Il s’agit d’une novella – un texte plus court qu’un roman mais plus long qu’une nouvelle – écrite en 2010 dans le cadre d’un programme d’alphabétisation canadien. On y retrouve, comme en concentré et dans un style privilégiant le dialogue, l’essentiel de l’univers de la grande écrivaine et plusieurs de ses personnages récurrents, dont l’inspecteur-chef Armand Gamache et son adjoint Jean-Guy Beauvoir.
« Le Pendu » se déroule dans un cadre également bien connu des lecteurs de Louise Penny. Three Pines – situé dans les Cantons-de-l’Est – est un hameau très réel et pourtant fictif où règne l’amitié, la bienveillance et l’entraide. Une harmonie qui contraste avec l’horreur du spectacle sur lequel s’ouvre le récit: un pendu. C’est un joggeur qui l’a découvert dans la forêt par un jour froid et humide de novembre. Armand Gamache a toutefois des doutes. Il lui semble peu probable que l’homme soit monté de lui-même dans l’arbre. Ses mains sont propres. Un meurtre maquillé en suicide? La piste se précise quand on découvre que la victime s’était inscrite à l’Auberge sous le nom de Arthur Ellis, celui du dernier bourreau officiel du Canada. Qui exécutait les condamnés par pendaison. Un élégant imbroglio où, comme souvent chez Louise Penny, l’Histoire s’invite dans l’intrigue.
 « Le Pendu ». De Louise Penny. Novella traduite de l’anglais par Lori Saint-Martin et Paul Gagné. Préambule de Marie-Christine Blais. Actes Sud, coll. Actes noirs, 100 p.
« Le Pendu ». De Louise Penny. Novella traduite de l’anglais par Lori Saint-Martin et Paul Gagné. Préambule de Marie-Christine Blais. Actes Sud, coll. Actes noirs, 100 p.
Les romans de Louise Penny sont plutôt replets. Ils oscillent en général entre 400 et 500 pages, des pavés donc, mais toujours intelligents, captivants et digestes. Petit cadeau de fin d’année, « Le Pendu », lui, compte moins de cent pages. Il s’agit d’une novella – un texte plus court qu’un roman mais plus long qu’une nouvelle […]
Quand les femmes qui ont du talent s’emparent du roman noir, elles le font avec un art inégalé. Des auteures comme Louise Penny ou Simone Buchholz en témoignent aujourd’hui. Et ce fut autrefois aussi le cas comme le rappelle « A contre-voie » de l’Américaine Gertrude Walker (1910-1994). Paru aux Etats-Unis en 1948, publié deux ans plus tard en français à la Série Noire, ce polar épopée intelligent, mordant, astucieux et souvent drôle se révèle un immense plaisir de lecture! Il vient d’être republié chez Gallimard dans une traduction révisée.
Gertrude Walker fut la première femme à intégrer la Série Noire dix ans après sa création. Un événement, comme le souligne Benoît Tadié dans la préface du livre car « Marcel Duhamel, son fondateur et directeur, aiguillait à l’époque les autrices – et les lectrices – de polars vers la Série Blême, sa petite sœur théoriquement réservée aux « romans à suspense » ou aux « romans angoissants » (…). » Est-ce à dire que Gertrude Walker écrit comme un homme? Pas du tout. Cette auteure, dont on connaît mal la biographie, possède à l’évidence un style, une inventivité, une perception du monde, voire une philosophie bien à elle.
« A contre-voie » est une histoire d’amour fou, ou plutôt de désir. Pour l’incarner, Gertrude Walker choisit de se glisser dans la peau d’un narrateur masculin, Walter Johnson, un dur au cœur généreux. Vagabond désargenté, cet errant magnifique débarque un beau jour d’un train de marchandises à la petite gare de Middletown, dans le Minnesota. Affamé, il cherche désespérément de quoi manger quand une femme, superbe mais à la voix terriblement laide, lui fait signe d’une fenêtre, lui demandant d’effectuer pour elle quelques achats. Le piège a tôt fait de se refermer. A peine entré dans l’appartement, notre héros tombe sur un cadavre. Elizabeth – ainsi se prénomme la dame – vient d’assassiner son conjoint et tente de le faire accuser à sa place.
Trois ans en compagnie du mal
Pour échapper à la police, Walter s’enfuit emmenant « en otage » avec lui cette femme aussi belle que monstrueuse et cruelle. Après trois ans de vie commune jalonnée de disputes, Elizabeth disparaît, laissant habilement derrière elle des traces suggérant qu’on l’a assassinée. Pas grand-chose en fait, mais suffisamment pour que Walter Johnson soit reconnu coupable et condamné à vingt ans de prison. Il en fera dix avant d’être libéré. Et de se lancer par vengeance – du moins se le répète-t-il – à la poursuite de cette femme insaisissable au sujet de laquelle il a bien dû admettre que « Dieu revêt parfois le diable d’un manteau de velours ».
Une grande partie du roman consiste donc en déplacements successifs. Balayant avec superbe les images attendues et les clichés, l’auteure en profite pour nous offrir de surprenantes et superbes descriptions de villes – notamment de New York – et de gens. Peu à peu, le lecteur découvre aussi la complexité de cet homme qui a perdu sa mère tout gosse et constate: « Il semble que les mecs dans mon genre perdent toujours leurs mères jeunes. C’est peut-être pour cela qu’ils deviennent des mecs dans mon genre. » Ce destin tragique ne l’empêche pas de se rêver peignant « l’âme des choses » et de se réinventer en « jardinier formidable » faisant pousser des plantes… en plein désert.
 « A contre-voie ». De Gertrude Walker. Traduction de Jacques Papy, révisée par Providence Garçon-Nsimire. Préface inédite de Benoît Tadié. Gallimard, Série Noire, 286 p.
« A contre-voie ». De Gertrude Walker. Traduction de Jacques Papy, révisée par Providence Garçon-Nsimire. Préface inédite de Benoît Tadié. Gallimard, Série Noire, 286 p.
Quand les femmes qui ont du talent s’emparent du roman noir, elles le font avec un art inégalé. Des auteures comme Louise Penny ou Simone Buchholz en témoignent aujourd’hui. Et ce fut autrefois aussi le cas comme le rappelle « A contre-voie » de l’Américaine Gertrude Walker (1910-1994). Paru aux Etats-Unis en 1948, publié deux ans plus […]
Les femmes tiennent rarement les premiers rôles dans les romans d’espionnage. Fan de ce genre éminemment masculin, l’Américaine Anna Pitoniak – alors éditrice chez Random House – s’en désolait. Elle a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’écrire elle-même le livre dont elle rêvait. « L’incident d’Helsinki » est son quatrième roman, mais le premier qui s’aventure véritablement dans l’univers des identités troubles et des trahisons institutionnalisées. Il s’articule autour du personnage riche et parfois douloureux d’Amanda Cole, une jeune et brillante espionne, elle-même fille d’espion. L’auteure en profite pour nous rappeler que, dans ce monde très particulier, la guerre froide n’a, de fait, jamais pris fin.
Dans la vie d’un agent secret, il existe des situations particulièrement stressantes. Par exemple d’apprendre, par le biais d’un transfuge, l’assassinat imminent d’un homme politique représentant son pays sans rien pouvoir faire pour l’empêcher. Travaillant à Rome comme adjointe du chef de poste de la CIA, Amanda Cole, 40 ans, se serait bien passé d’une telle expérience qui, outre son professionnalisme, va mettre à l’épreuve ses certitudes et ébranler les fondements même de son existence.
Un mystérieux visiteur
Bref! Voici ce qui s’est passé. Par une chaude et paisible journée de juillet, un homme bouleversé se présente à la porte de l’ambassade des Etats-Unis. Il est Russe. Il s’appelle Konstantin Semonov et – on l’apprend très vite – il travaille pour le GRU, la Direction générale du renseignement. Il annonce à Amanda – alors seule au bureau – que le sénateur américain Robert Vogel, en visite officielle au Caire, va être victime d’un AVC mortel le lendemain, en assistant à une parade militaire.
Semonov n’a bien sûr rien d’un devin. Sans révéler ses sources, il ajoute, espérant ainsi convaincre son interlocutrice: « Il existe des substances chimiques qui déclenchent dans le corps humain des symptômes très semblables à ceux d’un AVC. Si semblables qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute la conclusion du médecin. Surtout quand la personne décédée a quatre-vingts ans et une santé fragile. »
Info ou intox? Amanda balance. Elle en réfère aussitôt à son supérieur, qui la prend pour une folle et lui intime de ne pas réagir. Et le lendemain, Vogel meurt, comme annoncé. Taraudée par le remord, Amanda retrouve Semonov encore à Rome et commence à enquêter. Grâce à des papiers retrouvés chez le sénateur Vogel, elle apprend qu’il avait été informé par un riche oligarque de certaines manipulations financières permettant à la Russie de prendre le contrôle de puissantes entreprises étrangères. Dans la foulée, elle découvre dans ces notes lapidaires le nom de Charlie Cole, son propre père, un espion chevronné désormais retraité.
Sidération! Panique! Amanda va-t-elle flancher devant la vérité qu’elle pressent ou poursuivre son enquête jusqu’au bout de l’effroi? Mixant habilement les points de vue grâce à ses différents personnages, émaillant son récit de multiples flash-back, l’écrivaine Anna Pitoniak dénoue fil après fil le nœud d’une trahison qui eut pour cadre l’île de Särkkä, près d’Helsinki. Et pour contexte la fin des années 1980 dans une Finlande toujours sous l’emprise de son puissant voisin russe.
 « L’incident d’Helsinki ». D’Anna Pitoniak. Traduit de l’anglais par Jean Esch. Gallimard, Série noire, 424 p.
« L’incident d’Helsinki ». D’Anna Pitoniak. Traduit de l’anglais par Jean Esch. Gallimard, Série noire, 424 p.
Les femmes tiennent rarement les premiers rôles dans les romans d’espionnage. Fan de ce genre éminemment masculin, l’Américaine Anna Pitoniak – alors éditrice chez Random House – s’en désolait. Elle a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’écrire elle-même le livre dont elle rêvait. « L’incident d’Helsinki » est son quatrième roman, mais […]
La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité tragique d’un pays malmené par l’histoire, mais comme pour mieux la sublimer.
Mirinae Lee est née et a grandi en Corée du Sud. Elle vit aujourd’hui à Hong-Kong et écrit en anglais. « Les 8 Vies d’une mangeuse de terre », son premier roman, s’inspire de la vie de sa grand-tante qui, comme le personnage principal du livre, avait réussi à fuir la Corée du Nord. Fiction ou réalité? Témoignage ou fantasme? Ce livre composé de huit récits, et dont les propos parfois se recoupent, laisse une place généreuse au doute et à la liberté d’interprétation du lecteur.
L’histoire commence dans une maison de retraite où travaille Lee Sae-ri, l’initiatrice d’un curieux projet: un « programme d’écriture nécrologique ». Parallèlement à ses tâches d’assistante de direction, cette femme un brin déprimée, récemment divorcée, sans enfant, « quarante-sept ans et des kilos en trop », propose aux pensionnaires de lui raconter leur vie. Encourageante, elle suggère à ceux qui peinent à le faire de la résumer en trois mots. C’est dans ce contexte d’une grande intimité qu’elle rencontre l’étonnante et troublante Madame Mook.
Esclave, terroriste, meurtrière et mère
Mook Miran est une vieille dame originale et dynamique. D’emblée, elle lance, pour se définir: « Je suis née japonaise, j’ai été nord-coréenne une bonne partie de mon existence, et maintenant je suis une Sud-Coréenne en fin de vie. » Elle ajoute aussitôt que trois mots, c’est vraiment trop peu, qu’il lui en faut d’avantage pour raconter les différentes facettes de son existence: « Esclave. Reine de l’évasion. Meurtrière. Terroriste. Espionne. Amante. Et mère ». De quoi mettre l’eau à la bouche de sa confidente. Et bien sûr du lecteur captivé et captif que nous sommes devenus dès les premières pages.
Erratique, bondissant, le roman commence en 1961, par la cinquième vie. Il se poursuit en 1938, dans le petit village de Heoguri, près de la banlieue nord de Pyongyang, avec le meurtre d’un père tyrannique et violent. Il intègre aussi cette déroutante révélation: « Je mangeais de la terre quand j’étais jeune ». Mais pas n’importe quelle terre. Et pour nous en convaincre, Mme Mook nous offre une longue, et délicieuse, description de la terre parfaite dont la « viscosité devait être celle d’un riz au jasmin cuit à la vapeur, suffisamment pâteuse pour former une cuillerée, mais assez friable pour être emportée par un souffle ».
Espionne pour gagner sa liberté
Le récit de l’exploitation sexuelle des femmes coréennes par les Japonais, puis par les Américains – terribles sévices auxquels l’héroïne parvient à survivre – représente l’un des moments les plus douloureux du livre. Mais il y est aussi question d’amour. Un amour magique, respectueux, délicat. Lumineux. Et paradoxalement basé sur la duplicité. Championne des changements de noms, jongleuse de vies, Madame Mook – comme sa fille du reste – va donc tout naturellement mettre ses talents au service du gouvernement nord-coréen et devenir espionne. Une manière comme une autre de passer de l’autre côté et, finalement de gagner sa liberté, n’obtenant « la nationalité sud-coréenne qu’une fois ses cheveux devenus gris ». Elle meurt dans la maison de retraite au Soleil-Couchant, quasi-centenaire … et la langue « couverte d’une couche de terre, tel du sucre acidulé sur un bonbon ».
 « Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.
« Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.
La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité […]
Voilà un polar magnifiquement minimaliste. Et d’une diabolique habileté. Republié dans la sélection Classique de la Série Noire plus de soixante-cinq ans après sa première parution en français, « Et pourtant, elle tourne! » de l’Américaine Craig Rice (1908-1957) a pour principal décor une fête foraine située sur une jetée en bord de mer. Au menu, musiques tonitruantes, odeurs de friture, baraques abracadabrantes, amitiés fortes et complicités secrètes. Le fil conducteur du roman, au premier abord, semble lui aussi fort simple: une traque. La traque d’un assassin dont on connaît – ou croit connaître – d’emblée l’identité. Peu de suspense apparemment, mais ne vous y fiez pas trop!
Le meurtre s’est déroulé le temps d’une révolution de la grande roue, en pleine kermesse. La victime, poignardée dans le dos à l’aide d’un couteau de cuisine ordinaire, s’appelait Mac Gurn. Il était le boss des jeux clandestins. Pour les policiers – et pour le lecteur habilement piégé par l’auteure – le rusé Tony Webb s’impose comme le coupable idéal. Non seulement il vient de sortir de prison et se trouvait à la fête foraine au moment du crime, mais il avait un sérieux contentieux avec la victime. Reste à prouver sa culpabilité, et c’est là que tout se complique car Tony s’est fabriqué un solide alibi.
Il existe cependant une faille dans cette machinerie bien huilée. Un témoin potentiel. Au moment du crime, perchée sur un tabouret, Ellen posait pour Amby, le portraitiste de rue sourd-muet installé juste en face de la grande roue. Qu’a-t-elle vu? Art Smith, le chef de la Criminelle voudrait bien le savoir. Tony Webb également. Tous deux vont se mettre à la recherche de la jeune femme et s’éprendre follement de son mystère et de sa beauté. Le policier, qui n’a d’ordinaire pour religion que le règlement et pour bible le « Manuel des procédures policières », ira même jusqu’à évoquer dans son rapport sa « bouche semblable à une rose meurtrie ». On imagine la tête de son supérieur! La métaphore s’avérera tristement prémonitoire.
« Et pourtant elle tourne! » reste un roman atypique dans la production de Craig Rice plutôt tournée vers la comédie policière et le polar loufoque. De son vrai nom Georgiana Ann Randolph Walker Craig, cette autrice à succès fut, en 1946, la première femme auteure de romans noirs à faire la Une du Time Magazine. Ses livres figuraient alors parmi les plus grosses ventes, aux côtés de ceux de Raymond Chandler ou de Rex Stout. Paru en 1949, « Et pourtant elle tourne! » s’inscrit donc dans une autre veine, plus réaliste et noire. On y retrouve toutefois un des thèmes récurrents de son œuvre, nourri par sa propre biographie, celui de l’abandon. Dans ce magnifique roman, en effet, Ellen, qui aime tant les parcs d’attractions, et le triste policier Art Smith ont tous deux grandi en orphelinat.
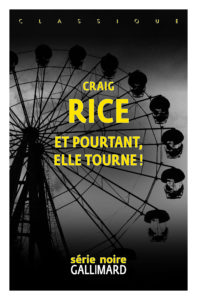 « Et pourtant, elle tourne! ». De Craig Rice. Traduction de l’anglais de Jacques Papy, révisée par Cécile Hermellin. Préface inédite de Natacha Levet. Gallimard, Collection Série Noire, Série Classique, 254 p.
« Et pourtant, elle tourne! ». De Craig Rice. Traduction de l’anglais de Jacques Papy, révisée par Cécile Hermellin. Préface inédite de Natacha Levet. Gallimard, Collection Série Noire, Série Classique, 254 p.
Voilà un polar magnifiquement minimaliste. Et d’une diabolique habileté. Republié dans la sélection Classique de la Série Noire plus de soixante-cinq ans après sa première parution en français, « Et pourtant, elle tourne! » de l’Américaine Craig Rice (1908-1957) a pour principal décor une fête foraine située sur une jetée en bord de mer. Au menu, musiques […]
A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.
Photo: Lara Schütz





