Quand Giancarlo De Cataldo parle de mafias et de trafics illicites, on peut lui faire confiance. Magistrat à la cour de Rome, parallèlement écrivain, essayiste et scénariste, il connaît son sujet sur le bout de la loi. C’est ainsi qu’en 2002, retraçant quinze ans de méfaits commis par une bande de truands romains, il signait un magistral et désormais historique « Romanzo criminale » adapté peu après au cinéma. Vingt ans plus tard, toujours avec le même panache mais par un autre biais, il revient sur ce thème malheureusement toujours actuel dans un roman sensible et triste, « La Suédoise ».
Situé à Rome en pleine pandémie de Covid, sobre et nerveux, le récit s’articule autour du destin d’une jeune fille de la banlieue déshéritée devenue dealeuse un peu malgré elle. Centrée sur cette personnalité riche et troublante, cette fiction nourrie du réel souligne dans la foulée que « les choses changent, même dans le milieu criminel » et que le marché de la drogue fonctionne aujourd’hui différemment d’autrefois, certaines zones étant tenues par des mafias importées, notamment par des clans albanais. L’auteur rappelle également qu’alors que les citoyens normaux vivaient confinés, la pègre, elle, continuait à travailler et à faire la fête, profitant même largement de la situation pour s’enrichir.
Grande, mince et blonde, Sharo – alias la Suédoise – s’était bien juré de se tenir à l’écart de tout acte délictueux. Pour vivre et faire vivre sa mère invalide, cette jeune femme pétillante d’intelligence, de curiosité et d’audace cumule les petits boulots précaires et parfois humiliants. Mais voilà qu’un jour, au cœur de la pandémie, son petit ami se fait renverser par une voiture. Pour l’aider, elle accepte à contre-cœur de livrer une bouteille de « Gina » – du GHB appelé aussi drogue du violeur – à un prince homosexuel plutôt bel homme, qui vit entouré de sa « cour » dans un palais du Centre-Ville. Prix du colis: cinq mille euros. Entre ce quinquagénaire étrange et doux et la jeune femme séduite par sa gentillesse et son éducation se tisse une relation ambigüe, vaguement malsaine. Le début d’un engrenage, le point de départ de l’irrésistible ascension de Sharo dans le monde du crime.
La Suédoise parviendra-t-elle à renoncer au bien-être que lui procurent le pouvoir et l’argent? Le lecteur sait d’emblée qu’il n’en est rien. Cela ne l’empêche pas de suivre avec une empathie amicale les diverses péripéties de cette jeune femme peu ordinaire qui a décidé de combattre à armes égales avec les hommes. Et sur leur propre terrain.
 « La Suédoise ». De Giancarlo De Cataldo. Traduit de l’italien par Anne Echenoz. Editions Métailié, 240 p.
« La Suédoise ». De Giancarlo De Cataldo. Traduit de l’italien par Anne Echenoz. Editions Métailié, 240 p.
Quand Giancarlo De Cataldo parle de mafias et de trafics illicites, on peut lui faire confiance. Magistrat à la cour de Rome, parallèlement écrivain, essayiste et scénariste, il connaît son sujet sur le bout de la loi. C’est ainsi qu’en 2002, retraçant quinze ans de méfaits commis par une bande de truands romains, il signait […]
Quand les femmes qui ont du talent s’emparent du roman noir, elles le font avec un art inégalé. Des auteures comme Louise Penny ou Simone Buchholz en témoignent aujourd’hui. Et ce fut autrefois aussi le cas comme le rappelle « A contre-voie » de l’Américaine Gertrude Walker (1910-1994). Paru aux Etats-Unis en 1948, publié deux ans plus tard en français à la Série Noire, ce polar épopée intelligent, mordant, astucieux et souvent drôle se révèle un immense plaisir de lecture! Il vient d’être republié chez Gallimard dans une traduction révisée.
Gertrude Walker fut la première femme à intégrer la Série Noire dix ans après sa création. Un événement, comme le souligne Benoît Tadié dans la préface du livre car « Marcel Duhamel, son fondateur et directeur, aiguillait à l’époque les autrices – et les lectrices – de polars vers la Série Blême, sa petite sœur théoriquement réservée aux « romans à suspense » ou aux « romans angoissants » (…). » Est-ce à dire que Gertrude Walker écrit comme un homme? Pas du tout. Cette auteure, dont on connaît mal la biographie, possède à l’évidence un style, une inventivité, une perception du monde, voire une philosophie bien à elle.
« A contre-voie » est une histoire d’amour fou, ou plutôt de désir. Pour l’incarner, Gertrude Walker choisit de se glisser dans la peau d’un narrateur masculin, Walter Johnson, un dur au cœur généreux. Vagabond désargenté, cet errant magnifique débarque un beau jour d’un train de marchandises à la petite gare de Middletown, dans le Minnesota. Affamé, il cherche désespérément de quoi manger quand une femme, superbe mais à la voix terriblement laide, lui fait signe d’une fenêtre, lui demandant d’effectuer pour elle quelques achats. Le piège a tôt fait de se refermer. A peine entré dans l’appartement, notre héros tombe sur un cadavre. Elizabeth – ainsi se prénomme la dame – vient d’assassiner son conjoint et tente de le faire accuser à sa place.
Trois ans en compagnie du mal
Pour échapper à la police, Walter s’enfuit emmenant « en otage » avec lui cette femme aussi belle que monstrueuse et cruelle. Après trois ans de vie commune jalonnée de disputes, Elizabeth disparaît, laissant habilement derrière elle des traces suggérant qu’on l’a assassinée. Pas grand-chose en fait, mais suffisamment pour que Walter Johnson soit reconnu coupable et condamné à vingt ans de prison. Il en fera dix avant d’être libéré. Et de se lancer par vengeance – du moins se le répète-t-il – à la poursuite de cette femme insaisissable au sujet de laquelle il a bien dû admettre que « Dieu revêt parfois le diable d’un manteau de velours ».
Une grande partie du roman consiste donc en déplacements successifs. Balayant avec superbe les images attendues et les clichés, l’auteure en profite pour nous offrir de surprenantes et superbes descriptions de villes – notamment de New York – et de gens. Peu à peu, le lecteur découvre aussi la complexité de cet homme qui a perdu sa mère tout gosse et constate: « Il semble que les mecs dans mon genre perdent toujours leurs mères jeunes. C’est peut-être pour cela qu’ils deviennent des mecs dans mon genre. » Ce destin tragique ne l’empêche pas de se rêver peignant « l’âme des choses » et de se réinventer en « jardinier formidable » faisant pousser des plantes… en plein désert.
 « A contre-voie ». De Gertrude Walker. Traduction de Jacques Papy, révisée par Providence Garçon-Nsimire. Préface inédite de Benoît Tadié. Gallimard, Série Noire, 286 p.
« A contre-voie ». De Gertrude Walker. Traduction de Jacques Papy, révisée par Providence Garçon-Nsimire. Préface inédite de Benoît Tadié. Gallimard, Série Noire, 286 p.
Quand les femmes qui ont du talent s’emparent du roman noir, elles le font avec un art inégalé. Des auteures comme Louise Penny ou Simone Buchholz en témoignent aujourd’hui. Et ce fut autrefois aussi le cas comme le rappelle « A contre-voie » de l’Américaine Gertrude Walker (1910-1994). Paru aux Etats-Unis en 1948, publié deux ans plus […]
« Le Mal. Chant de D’arco I » d’Antonio Moresco est une rareté, un vrai délice de liberté et d’inventivité créatrice. Ce thriller métaphysique – comme le désigne la critique – présente toutefois quelques faiblesses. Après un départ flamboyant, le récit par moments s’enlise dans une logorrhée répétitive et obsessionnelle qui frise la saturation. On tutoie l’ennui. Dans la dernière partie, heureusement, l’auteur retrouve son punch, renoue avec l’urgence et l’incandescence du début. Ces quelques « défauts » n’entament donc pas l’intérêt de ce roman, la première incursion dans le noir d’un des grands auteurs italiens contemporains, un écrivain qui, né en 1947 à Mantoue, a connu dans sa jeunesse aussi bien le séminaire que la lutte révolutionnaire.
Premier volet d’une trilogie, « Le Mal » commence par une révélation choc du personnage principal: « Je m’appelle D’Arco et je suis un flic mort. » Détail aggravant, et passablement déconcertant, notre héros, bien que retraité de la vie, est toujours en poste, « affecté depuis trois ans au commissariat central de la ville des morts ». Malgré son corps couturé de cicatrices et ses yeux devenus blancs, il mène une existence relativement normale dans cette cité hypermoderne et fébrile, une pépinière de rues et de routes hérissée de gratte-ciel, de centres commerciaux et de chantiers. Un environnement calqué sur le nôtre, à une nuance près. S’il l’on prête l’oreille et que l’on sait écouter, on y entend la nuit des voix déchirant le silence, un chant lent et doux comme une berceuse, le chant des enfants morts.
Chargé par un mystérieux personnage de découvrir l’origine et la cause de cette hécatombe d’enfants, D’Arco se lance dans une croisade littéralement donquichottesque. Epaulé par un tout jeune complice devenu muet à la suite des sévices qu’il a subis, il retourne dans la ville des vivants pour tenter d’arrêter le massacre et châtier les coupables. Armé jusqu’aux dents, il multiplie les opérations spectaculaires, mais arrive toujours trop tard. Les enfants sont déjà morts.
« Le Mal » se présente donc comme une parabole, ou un conte, sur le bien, le mal, la vie, la mort, et même l’amour. Avec la complicité du lecteur, Antonio Moresco s’approprie malicieusement les codes du roman noir pour mieux les détourner. Il nous offre ainsi, sur trois pages, la liste de tous les clichés du genre que l’on ne trouvera pas dans son roman, qu’il s’agisse de descriptions minutieuses de l’horreur, du « catalogue des dernières nouveautés en matière de balistique » ou des différents modèles de pistolets-mitrailleurs. Cela n’empêche pas son héros de réclamer au commissariat de la ville des vivants une longue liste d’armes à mettre à sa disposition. Dont une arbalète avec visée infrarouge, un couteau, une dague et … un petit canon.
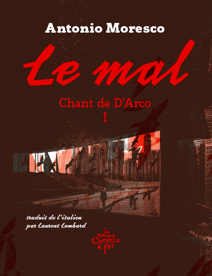 « Le Mal. Chant de D’arco I ». D’Antonio Moresco. Traduit de l’italien par Laurent Lombard. Les éditions du Chemin de fer, 288 p. En librairie le 7 novembre 2025.
« Le Mal. Chant de D’arco I ». D’Antonio Moresco. Traduit de l’italien par Laurent Lombard. Les éditions du Chemin de fer, 288 p. En librairie le 7 novembre 2025.
« Le Mal. Chant de D’arco I » d’Antonio Moresco est une rareté, un vrai délice de liberté et d’inventivité créatrice. Ce thriller métaphysique – comme le désigne la critique – présente toutefois quelques faiblesses. Après un départ flamboyant, le récit par moments s’enlise dans une logorrhée répétitive et obsessionnelle qui frise la saturation. On tutoie l’ennui. […]
Les femmes tiennent rarement les premiers rôles dans les romans d’espionnage. Fan de ce genre éminemment masculin, l’Américaine Anna Pitoniak – alors éditrice chez Random House – s’en désolait. Elle a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’écrire elle-même le livre dont elle rêvait. « L’incident d’Helsinki » est son quatrième roman, mais le premier qui s’aventure véritablement dans l’univers des identités troubles et des trahisons institutionnalisées. Il s’articule autour du personnage riche et parfois douloureux d’Amanda Cole, une jeune et brillante espionne, elle-même fille d’espion. L’auteure en profite pour nous rappeler que, dans ce monde très particulier, la guerre froide n’a, de fait, jamais pris fin.
Dans la vie d’un agent secret, il existe des situations particulièrement stressantes. Par exemple d’apprendre, par le biais d’un transfuge, l’assassinat imminent d’un homme politique représentant son pays sans rien pouvoir faire pour l’empêcher. Travaillant à Rome comme adjointe du chef de poste de la CIA, Amanda Cole, 40 ans, se serait bien passé d’une telle expérience qui, outre son professionnalisme, va mettre à l’épreuve ses certitudes et ébranler les fondements même de son existence.
Un mystérieux visiteur
Bref! Voici ce qui s’est passé. Par une chaude et paisible journée de juillet, un homme bouleversé se présente à la porte de l’ambassade des Etats-Unis. Il est Russe. Il s’appelle Konstantin Semonov et – on l’apprend très vite – il travaille pour le GRU, la Direction générale du renseignement. Il annonce à Amanda – alors seule au bureau – que le sénateur américain Robert Vogel, en visite officielle au Caire, va être victime d’un AVC mortel le lendemain, en assistant à une parade militaire.
Semonov n’a bien sûr rien d’un devin. Sans révéler ses sources, il ajoute, espérant ainsi convaincre son interlocutrice: « Il existe des substances chimiques qui déclenchent dans le corps humain des symptômes très semblables à ceux d’un AVC. Si semblables qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute la conclusion du médecin. Surtout quand la personne décédée a quatre-vingts ans et une santé fragile. »
Info ou intox? Amanda balance. Elle en réfère aussitôt à son supérieur, qui la prend pour une folle et lui intime de ne pas réagir. Et le lendemain, Vogel meurt, comme annoncé. Taraudée par le remord, Amanda retrouve Semonov encore à Rome et commence à enquêter. Grâce à des papiers retrouvés chez le sénateur Vogel, elle apprend qu’il avait été informé par un riche oligarque de certaines manipulations financières permettant à la Russie de prendre le contrôle de puissantes entreprises étrangères. Dans la foulée, elle découvre dans ces notes lapidaires le nom de Charlie Cole, son propre père, un espion chevronné désormais retraité.
Sidération! Panique! Amanda va-t-elle flancher devant la vérité qu’elle pressent ou poursuivre son enquête jusqu’au bout de l’effroi? Mixant habilement les points de vue grâce à ses différents personnages, émaillant son récit de multiples flash-back, l’écrivaine Anna Pitoniak dénoue fil après fil le nœud d’une trahison qui eut pour cadre l’île de Särkkä, près d’Helsinki. Et pour contexte la fin des années 1980 dans une Finlande toujours sous l’emprise de son puissant voisin russe.
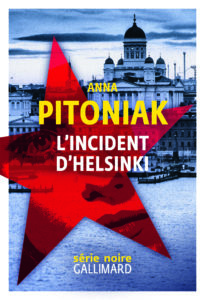 « L’incident d’Helsinki ». D’Anna Pitoniak. Traduit de l’anglais par Jean Esch. Gallimard, Série noire, 424 p.
« L’incident d’Helsinki ». D’Anna Pitoniak. Traduit de l’anglais par Jean Esch. Gallimard, Série noire, 424 p.
Les femmes tiennent rarement les premiers rôles dans les romans d’espionnage. Fan de ce genre éminemment masculin, l’Américaine Anna Pitoniak – alors éditrice chez Random House – s’en désolait. Elle a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’écrire elle-même le livre dont elle rêvait. « L’incident d’Helsinki » est son quatrième roman, mais […]
La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité tragique d’un pays malmené par l’histoire, mais comme pour mieux la sublimer.
Mirinae Lee est née et a grandi en Corée du Sud. Elle vit aujourd’hui à Hong-Kong et écrit en anglais. « Les 8 Vies d’une mangeuse de terre », son premier roman, s’inspire de la vie de sa grand-tante qui, comme le personnage principal du livre, avait réussi à fuir la Corée du Nord. Fiction ou réalité? Témoignage ou fantasme? Ce livre composé de huit récits, et dont les propos parfois se recoupent, laisse une place généreuse au doute et à la liberté d’interprétation du lecteur.
L’histoire commence dans une maison de retraite où travaille Lee Sae-ri, l’initiatrice d’un curieux projet: un « programme d’écriture nécrologique ». Parallèlement à ses tâches d’assistante de direction, cette femme un brin déprimée, récemment divorcée, sans enfant, « quarante-sept ans et des kilos en trop », propose aux pensionnaires de lui raconter leur vie. Encourageante, elle suggère à ceux qui peinent à le faire de la résumer en trois mots. C’est dans ce contexte d’une grande intimité qu’elle rencontre l’étonnante et troublante Madame Mook.
Esclave, terroriste, meurtrière et mère
Mook Miran est une vieille dame originale et dynamique. D’emblée, elle lance, pour se définir: « Je suis née japonaise, j’ai été nord-coréenne une bonne partie de mon existence, et maintenant je suis une Sud-Coréenne en fin de vie. » Elle ajoute aussitôt que trois mots, c’est vraiment trop peu, qu’il lui en faut d’avantage pour raconter les différentes facettes de son existence: « Esclave. Reine de l’évasion. Meurtrière. Terroriste. Espionne. Amante. Et mère ». De quoi mettre l’eau à la bouche de sa confidente. Et bien sûr du lecteur captivé et captif que nous sommes devenus dès les premières pages.
Erratique, bondissant, le roman commence en 1961, par la cinquième vie. Il se poursuit en 1938, dans le petit village de Heoguri, près de la banlieue nord de Pyongyang, avec le meurtre d’un père tyrannique et violent. Il intègre aussi cette déroutante révélation: « Je mangeais de la terre quand j’étais jeune ». Mais pas n’importe quelle terre. Et pour nous en convaincre, Mme Mook nous offre une longue, et délicieuse, description de la terre parfaite dont la « viscosité devait être celle d’un riz au jasmin cuit à la vapeur, suffisamment pâteuse pour former une cuillerée, mais assez friable pour être emportée par un souffle ».
Espionne pour gagner sa liberté
Le récit de l’exploitation sexuelle des femmes coréennes par les Japonais, puis par les Américains – terribles sévices auxquels l’héroïne parvient à survivre – représente l’un des moments les plus douloureux du livre. Mais il y est aussi question d’amour. Un amour magique, respectueux, délicat. Lumineux. Et paradoxalement basé sur la duplicité. Championne des changements de noms, jongleuse de vies, Madame Mook – comme sa fille du reste – va donc tout naturellement mettre ses talents au service du gouvernement nord-coréen et devenir espionne. Une manière comme une autre de passer de l’autre côté et, finalement de gagner sa liberté, n’obtenant « la nationalité sud-coréenne qu’une fois ses cheveux devenus gris ». Elle meurt dans la maison de retraite au Soleil-Couchant, quasi-centenaire … et la langue « couverte d’une couche de terre, tel du sucre acidulé sur un bonbon ».
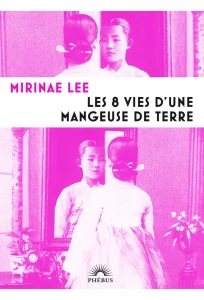 « Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.
« Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.
La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité […]
J’adore les polars du Norvégien Jørn Lier Horst. Je les préfère toutefois écrits à deux plutôt qu’à quatre mains. Bien qu’un peu sec, privilégiant avant tout la dynamique et l’efficacité des dialogues, « Faux-semblant », son deuxième roman cosigné avec le journaliste Thomas Enger, reste fort bon. Il s’avère même par moments virtuose dans l’art de brouiller les pistes, de rebondir et de surprendre. On y retrouve les deux fins limiers apparus dans « Que le meilleur gagne », le premier épisode de cette nouvelle série: l’inspecteur Alex Blix et la jeune journaliste Emma Ramm. Deux êtres discrètement complices que relie un tragique épisode de leur passé commun.
« Faux-semblant » commence comme se terminait le roman précédent, par un compte à rebours. Un événement banal en l’occurrence, celui qui précède l’entrée dans la nouvelle année. Emma n’en est pas moins animée par un terrible pressentiment. Quittant ses proches et le réveillon, elle se rend seule sur la place de l’hôtel de ville où se déroulent les festivités. Et quand minuit arrive, sa crainte se confirme. Parallèlement au feu d’artifice, une terrible explosion survient. La bombe avait été placée dans une poubelle. Bilan: de nombreux blessés et quatre morts, dont Kasper, le compagnon d’Emma.
Appelé en urgence sur les lieux, Blix aperçoit un corps qui flotte dans l’eau du port. Sans hésiter, il plonge dans les flots glacés et ramène à terre une jeune femme inanimée, grièvement blessée. La carte bancaire retrouvée sur elle permet de l’identifier. Elle se nomme Ruth-Kristine Smeplass. Une information qui agit sur Blix comme un électrochoc. Cette femme serait donc la mère de Patricia, la fillette d’un an enlevée dans sa poussette en 2009. Elle ne fut jamais retrouvée, pas plus que son ravisseur.
Pas une minute à perdre. Alors que la police privilégie la piste terroriste, Blix rouvre le dossier, réinterroge les témoins et les proches, constatant dans la foulée que certains ont brusquement et mystérieusement disparu. Bouleversée par la perte de son compagnon, Emma elle aussi se jette à corps perdu dans l’enquête et parvient à remonter la piste des coupables dans le sillage du policier. Pour l’un comme pour l’autre, les pièces du puzzle peu à peu s’assemblent tandis que se multiplient retournements et coups de théâtre. Patricia est-elle encore en vie? Fort habilement et jusqu’à la fin du roman, les deux auteurs parviennent à nourrir le doute et à entretenir le suspense.
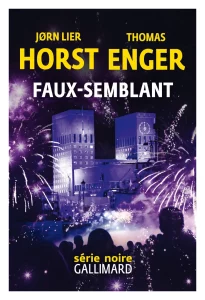 « Faux-semblant ». De Jørn Lier Horst et Thomas Enger. Traduction de Marie-Caroline Aubert. Gallimard, Série noire, 416 p.
« Faux-semblant ». De Jørn Lier Horst et Thomas Enger. Traduction de Marie-Caroline Aubert. Gallimard, Série noire, 416 p.
Sur « Que le meilleur gagne », qui sort parallèlement en poche: https://polarspolisetcie.com/un-machiavelique-compte-a-rebours/
J’adore les polars du Norvégien Jørn Lier Horst. Je les préfère toutefois écrits à deux plutôt qu’à quatre mains. Bien qu’un peu sec, privilégiant avant tout la dynamique et l’efficacité des dialogues, « Faux-semblant », son deuxième roman cosigné avec le journaliste Thomas Enger, reste fort bon. Il s’avère même par moments virtuose dans l’art de brouiller […]
A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.
Photo: Lara Schütz





