Les femmes tiennent rarement les premiers rôles dans les romans d’espionnage. Fan de ce genre éminemment masculin, l’Américaine Anna Pitoniak – alors éditrice chez Random House – s’en désolait. Elle a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’écrire elle-même le livre dont elle rêvait. « L’incident d’Helsinki » est son quatrième roman, mais le premier qui s’aventure véritablement dans l’univers des identités troubles et des trahisons institutionnalisées. Il s’articule autour du personnage riche et parfois douloureux d’Amanda Cole, une jeune et brillante espionne, elle-même fille d’espion. L’auteure en profite pour nous rappeler que, dans ce monde très particulier, la guerre froide n’a, de fait, jamais pris fin.
Dans la vie d’un agent secret, il existe des situations particulièrement stressantes. Par exemple d’apprendre, par le biais d’un transfuge, l’assassinat imminent d’un homme politique représentant son pays sans rien pouvoir faire pour l’empêcher. Travaillant à Rome comme adjointe du chef de poste de la CIA, Amanda Cole, 40 ans, se serait bien passé d’une telle expérience qui, outre son professionnalisme, va mettre à l’épreuve ses certitudes et ébranler les fondements même de son existence.
Un mystérieux visiteur
Bref! Voici ce qui s’est passé. Par une chaude et paisible journée de juillet, un homme bouleversé se présente à la porte de l’ambassade des Etats-Unis. Il est Russe. Il s’appelle Konstantin Semonov et – on l’apprend très vite – il travaille pour le GRU, la Direction générale du renseignement. Il annonce à Amanda – alors seule au bureau – que le sénateur américain Robert Vogel, en visite officielle au Caire, va être victime d’un AVC mortel le lendemain, en assistant à une parade militaire.
Semonov n’a bien sûr rien d’un devin. Sans révéler ses sources, il ajoute, espérant ainsi convaincre son interlocutrice: « Il existe des substances chimiques qui déclenchent dans le corps humain des symptômes très semblables à ceux d’un AVC. Si semblables qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute la conclusion du médecin. Surtout quand la personne décédée a quatre-vingts ans et une santé fragile. »
Info ou intox? Amanda balance. Elle en réfère aussitôt à son supérieur, qui la prend pour une folle et lui intime de ne pas réagir. Et le lendemain, Vogel meurt, comme annoncé. Taraudée par le remord, Amanda retrouve Semonov encore à Rome et commence à enquêter. Grâce à des papiers retrouvés chez le sénateur Vogel, elle apprend qu’il avait été informé par un riche oligarque de certaines manipulations financières permettant à la Russie de prendre le contrôle de puissantes entreprises étrangères. Dans la foulée, elle découvre dans ces notes lapidaires le nom de Charlie Cole, son propre père, un espion chevronné désormais retraité.
Sidération! Panique! Amanda va-t-elle flancher devant la vérité qu’elle pressent ou poursuivre son enquête jusqu’au bout de l’effroi? Mixant habilement les points de vue grâce à ses différents personnages, émaillant son récit de multiples flash-back, l’écrivaine Anna Pitoniak dénoue fil après fil le nœud d’une trahison qui eut pour cadre l’île de Särkkä, près d’Helsinki. Et pour contexte la fin des années 1980 dans une Finlande toujours sous l’emprise de son puissant voisin russe.
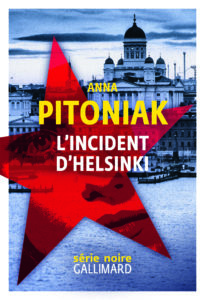 « L’incident d’Helsinki ». D’Anna Pitoniak. Traduit de l’anglais par Jean Esch. Gallimard, Série noire, 424 p.
« L’incident d’Helsinki ». D’Anna Pitoniak. Traduit de l’anglais par Jean Esch. Gallimard, Série noire, 424 p.
Les femmes tiennent rarement les premiers rôles dans les romans d’espionnage. Fan de ce genre éminemment masculin, l’Américaine Anna Pitoniak – alors éditrice chez Random House – s’en désolait. Elle a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’écrire elle-même le livre dont elle rêvait. « L’incident d’Helsinki » est son quatrième roman, mais […]
La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité tragique d’un pays malmené par l’histoire, mais comme pour mieux la sublimer.
Mirinae Lee est née et a grandi en Corée du Sud. Elle vit aujourd’hui à Hong-Kong et écrit en anglais. « Les 8 Vies d’une mangeuse de terre », son premier roman, s’inspire de la vie de sa grand-tante qui, comme le personnage principal du livre, avait réussi à fuir la Corée du Nord. Fiction ou réalité? Témoignage ou fantasme? Ce livre composé de huit récits, et dont les propos parfois se recoupent, laisse une place généreuse au doute et à la liberté d’interprétation du lecteur.
L’histoire commence dans une maison de retraite où travaille Lee Sae-ri, l’initiatrice d’un curieux projet: un « programme d’écriture nécrologique ». Parallèlement à ses tâches d’assistante de direction, cette femme un brin déprimée, récemment divorcée, sans enfant, « quarante-sept ans et des kilos en trop », propose aux pensionnaires de lui raconter leur vie. Encourageante, elle suggère à ceux qui peinent à le faire de la résumer en trois mots. C’est dans ce contexte d’une grande intimité qu’elle rencontre l’étonnante et troublante Madame Mook.
Esclave, terroriste, meurtrière et mère
Mook Miran est une vieille dame originale et dynamique. D’emblée, elle lance, pour se définir: « Je suis née japonaise, j’ai été nord-coréenne une bonne partie de mon existence, et maintenant je suis une Sud-Coréenne en fin de vie. » Elle ajoute aussitôt que trois mots, c’est vraiment trop peu, qu’il lui en faut d’avantage pour raconter les différentes facettes de son existence: « Esclave. Reine de l’évasion. Meurtrière. Terroriste. Espionne. Amante. Et mère ». De quoi mettre l’eau à la bouche de sa confidente. Et bien sûr du lecteur captivé et captif que nous sommes devenus dès les premières pages.
Erratique, bondissant, le roman commence en 1961, par la cinquième vie. Il se poursuit en 1938, dans le petit village de Heoguri, près de la banlieue nord de Pyongyang, avec le meurtre d’un père tyrannique et violent. Il intègre aussi cette déroutante révélation: « Je mangeais de la terre quand j’étais jeune ». Mais pas n’importe quelle terre. Et pour nous en convaincre, Mme Mook nous offre une longue, et délicieuse, description de la terre parfaite dont la « viscosité devait être celle d’un riz au jasmin cuit à la vapeur, suffisamment pâteuse pour former une cuillerée, mais assez friable pour être emportée par un souffle ».
Espionne pour gagner sa liberté
Le récit de l’exploitation sexuelle des femmes coréennes par les Japonais, puis par les Américains – terribles sévices auxquels l’héroïne parvient à survivre – représente l’un des moments les plus douloureux du livre. Mais il y est aussi question d’amour. Un amour magique, respectueux, délicat. Lumineux. Et paradoxalement basé sur la duplicité. Championne des changements de noms, jongleuse de vies, Madame Mook – comme sa fille du reste – va donc tout naturellement mettre ses talents au service du gouvernement nord-coréen et devenir espionne. Une manière comme une autre de passer de l’autre côté et, finalement de gagner sa liberté, n’obtenant « la nationalité sud-coréenne qu’une fois ses cheveux devenus gris ». Elle meurt dans la maison de retraite au Soleil-Couchant, quasi-centenaire … et la langue « couverte d’une couche de terre, tel du sucre acidulé sur un bonbon ».
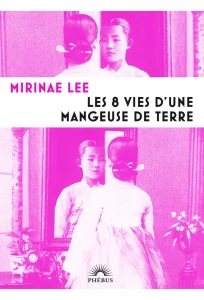 « Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.
« Les 8 Vies d’une mangeuse de terre ». De Mirinae Lee. Traduit de l’anglais par Lou Gonse. Phébus, 318 p.
La littérature coréenne se révèle parfois d’une cruauté brute et d’une violence quasi-insupportable. Elle peut aussi s’avérer bouleversante d’humanité, de respect, de tendresse. « Les 8 vies d’une mangeuse de terre » de Mirinae Lee appartient à cette deuxième catégorie. Porté par un art de la narration littéralement envoûtant, ce roman complexe s’ancre, certes, dans la réalité […]
Voilà un polar magnifiquement minimaliste. Et d’une diabolique habileté. Republié dans la sélection Classique de la Série Noire plus de soixante-cinq ans après sa première parution en français, « Et pourtant, elle tourne! » de l’Américaine Craig Rice (1908-1957) a pour principal décor une fête foraine située sur une jetée en bord de mer. Au menu, musiques tonitruantes, odeurs de friture, baraques abracadabrantes, amitiés fortes et complicités secrètes. Le fil conducteur du roman, au premier abord, semble lui aussi fort simple: une traque. La traque d’un assassin dont on connaît – ou croit connaître – d’emblée l’identité. Peu de suspense apparemment, mais ne vous y fiez pas trop!
Le meurtre s’est déroulé le temps d’une révolution de la grande roue, en pleine kermesse. La victime, poignardée dans le dos à l’aide d’un couteau de cuisine ordinaire, s’appelait Mac Gurn. Il était le boss des jeux clandestins. Pour les policiers – et pour le lecteur habilement piégé par l’auteure – le rusé Tony Webb s’impose comme le coupable idéal. Non seulement il vient de sortir de prison et se trouvait à la fête foraine au moment du crime, mais il avait un sérieux contentieux avec la victime. Reste à prouver sa culpabilité, et c’est là que tout se complique car Tony s’est fabriqué un solide alibi.
Il existe cependant une faille dans cette machinerie bien huilée. Un témoin potentiel. Au moment du crime, perchée sur un tabouret, Ellen posait pour Amby, le portraitiste de rue sourd-muet installé juste en face de la grande roue. Qu’a-t-elle vu? Art Smith, le chef de la Criminelle voudrait bien le savoir. Tony Webb également. Tous deux vont se mettre à la recherche de la jeune femme et s’éprendre follement de son mystère et de sa beauté. Le policier, qui n’a d’ordinaire pour religion que le règlement et pour bible le « Manuel des procédures policières », ira même jusqu’à évoquer dans son rapport sa « bouche semblable à une rose meurtrie ». On imagine la tête de son supérieur! La métaphore s’avérera tristement prémonitoire.
« Et pourtant elle tourne! » reste un roman atypique dans la production de Craig Rice plutôt tournée vers la comédie policière et le polar loufoque. De son vrai nom Georgiana Ann Randolph Walker Craig, cette autrice à succès fut, en 1946, la première femme auteure de romans noirs à faire la Une du Time Magazine. Ses livres figuraient alors parmi les plus grosses ventes, aux côtés de ceux de Raymond Chandler ou de Rex Stout. Paru en 1949, « Et pourtant elle tourne! » s’inscrit donc dans une autre veine, plus réaliste et noire. On y retrouve toutefois un des thèmes récurrents de son œuvre, nourri par sa propre biographie, celui de l’abandon. Dans ce magnifique roman, en effet, Ellen, qui aime tant les parcs d’attractions, et le triste policier Art Smith ont tous deux grandi en orphelinat.
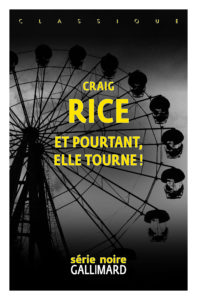 « Et pourtant, elle tourne! ». De Craig Rice. Traduction de l’anglais de Jacques Papy, révisée par Cécile Hermellin. Préface inédite de Natacha Levet. Gallimard, Collection Série Noire, Série Classique, 254 p.
« Et pourtant, elle tourne! ». De Craig Rice. Traduction de l’anglais de Jacques Papy, révisée par Cécile Hermellin. Préface inédite de Natacha Levet. Gallimard, Collection Série Noire, Série Classique, 254 p.
Voilà un polar magnifiquement minimaliste. Et d’une diabolique habileté. Republié dans la sélection Classique de la Série Noire plus de soixante-cinq ans après sa première parution en français, « Et pourtant, elle tourne! » de l’Américaine Craig Rice (1908-1957) a pour principal décor une fête foraine située sur une jetée en bord de mer. Au menu, musiques […]
Une grosse surprise, teintée d’un brin de déception, mais vite oubliée. Après cinq enquêtes menées tambour battant par son efficace duo Wyndham-Banerjee, l’Anglais Abir Mukherjee quitte l’Inde – le pays de sa famille – et les années 1920 pour s’installer dans l’Amérique contemporaine. Un désir de changement bien compréhensible. Et qui lui réussit parfaitement. « Les Fugitifs » est un polar palpitant, complexe et superbement construit. Un polar sous tension, né de la colère de l’auteur contre ce qu’il advient du monde.
Le roman se situe à la toute fin d’une élection présidentielle très disputée et dont l’issue s’avère plus qu’incertaine. Face à Greenwood, la vice-présidente démocrate, se dresse avec toute sa morgue et son arrogance un républicain nommé Costa « que la moitié de la population américaine considère comme un cinglé narcissique qui tuerait sa propre mère pour entrer à la Maison Blanche ». Toute ressemblance avec des personnes existantes n’est bien sûr pas fortuite. Mukherjee précise par ailleurs avoir commencé son roman avant l’attaque du Capitole par les partisans de Trump.
Une fois le contexte posé, l’auteur construit librement une intrigue qui fait la part belle à la corruption, au complot et qui se situe d’emblée dans la veine du thriller. Ecrit à la troisième personne et porté par différents narrateurs, le récit commence avec un attentat dans un centre commercial de Los Angeles. Un acte barbare que l’on « vit » aux côtés de la poseuse de bombe, une jeune fille volontairement sacrifiée des commanditaires qui se font appeler « Les Fils du califat ». Un nom parfaitement inconnu des spécialistes du terrorisme!
Aussitôt après l’explosion, prenant des risques considérables, Shreya Mistry, agente spéciale du FBI, se précipite à l’intérieur du bâtiment qui menace de s’effondrer. Impétueuse et indocile, cette jeune femme d’origine indienne retrouve ainsi, par miracle, les vidéos de surveillance où l’on voit la kamikaze courir, sortir son téléphone… et mourir. Pourquoi courait-elle? Avait-elle été piégée? Cet attentat meurtrier n’était-il que le premier d’une série machiavéliquement planifiée avant les élections pour déstabiliser l’Amérique? Hantée par ces questions, ignorant les sanctions et les brimades de sa hiérarchie, Shreya va alors tout mettre en œuvre pour retrouver une jeune femme, Aliyah qui, venue de Londres, était entrée sur le territoire américain en même temps que la poseuse de bombe.
A l’enquête « officielle » se superpose alors une deuxième traque plus discrète. Prévenu que sa fille est en danger, le père d’Aliyah tente de la retrouver avec l’aide d’une Américaine dont le fils, lui aussi disparu, semble pris dans le même engrenage. Et l’auteur profite de cette double course – poursuite pour nous faire traverser les Etats-Unis de part en part. Le chemin des parents éplorés finit par croiser la route de l’agente du FBI. Et le tout se termine dans une monstre bastringue électorale avec mouvements de foule et ambiance survoltée, une apothéose tragique et très cinématographique dont l’auteur a le secret. Glissant de découverte en révélation, ce dernier parvient en outre à nous tenir en haleine jusqu’au bout. Dans « Les Fugitifs », l’identité des traitres et leurs motivations sont en effet susceptibles de changer jusqu’au dernier moment.
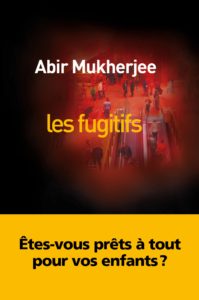 « Les Fugitifs ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Pierre Reignier. Editions Liana Levi, 408 p.
« Les Fugitifs ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Pierre Reignier. Editions Liana Levi, 408 p.
Sur d’autres livres d’Abir Mukherjee:
https://polarspolisetcie.com/le-mystere-indien-de-la-chambre-close/
https://polarspolisetcie.com/traque-sans-merci-au-coeur-de-la-poudriere-indienne/
Une grosse surprise, teintée d’un brin de déception, mais vite oubliée. Après cinq enquêtes menées tambour battant par son efficace duo Wyndham-Banerjee, l’Anglais Abir Mukherjee quitte l’Inde – le pays de sa famille – et les années 1920 pour s’installer dans l’Amérique contemporaine. Un désir de changement bien compréhensible. Et qui lui réussit parfaitement. « Les […]
Se lancer dans une nouvelle aventure littéraire à 68 ans, voilà qui est plutôt rare et courageux. Après une cinquantaine de polars à succès mettant en scène ses personnages fétiches – le flic Harry Bosch, l’avocat Mickey Haller, l’inspectrice Renée Ballard et le journaliste Jack McEvoy – Michael Connelly change de décor et de héros. Dans « Sous les eaux d’Avalon », son dernier polar, l’écrivain américain quitte la vie trépidante de Los Angeles pour le cadre idyllique de Santa Catalina, une île rocheuse de 194 km2 située à 35 kilomètres du continent. Et pour nous la faire découvrir, il crée de toutes pièces un nouvel enquêteur, un homme têtu, intègre et courageux, l’inspecteur Stilwell.
Ce parti pris nous permet d’assister en direct à la naissance d’un personnage, à la manière dont ce dernier peu à peu s’ancre dans la fiction. Au départ, on ne sait rien de lui. Ensuite progressivement, comme dans un film, les choses s’éclairent, prennent forme et des repères se mettent en place. La figure de Stilwell se dessine, avec un passé, des sentiments. On découvre notamment qu’il entretient une relation amoureuse stable avec Tash – une nouveauté dans l’univers romanesque de Michael Connelly.
Un cadavre bien gênant découvert sous un bateau
Débarqué de l’unité des Homicides du LAPD (Los Angeles Police Department), Stilwell a atterri à Santa Catalina après une embrouille avec un collègue peu scrupuleux. Il s’agit donc d’un placard, même pas doré, d’une manière de le punir en lui coupant les ailes. « En sa qualité d’inspecteur assigné à Avalon (la ville principale de Santa Catalina, réd.), c’était lui qui commandait les forces de l’île. Cet honneur lui valait tout un tas de tâches de gestion et d’administration qu’il n’acceptait qu’à regret », précise l’auteur.
En temps normal, à part quelques délits mineurs, il ne se passe par grand-chose dans ce paradis protégé pour touriste fortunés. Peu après l’arrivée de Stilwell, toutefois, la situation se dégrade. Outre une histoire de bison mutilé, et en plus de l’agression d’un officier de police dans un bar, notre inspecteur se retrouve avec un cadavre sur les bras. Il s’agit d’une jeune femme à la réputation un brin sulfureuse qui travaillait dans un club privé très sélect. Son corps, enveloppé dans une bâche et lesté, a été retrouvé sous un bateau du port.
En pleine saison touristique, le maire tente d’étouffer l’affaire. Il est aidé par des policiers qui, envoyés du continent, se contentent d’enquêter mollement. Bien qu’officiellement tenu à l’écart, Stilwell ne peut rester inactif. Il part sur les traces du tueur et dénonce les conclusions hâtives de ses collègues, s’attirant les remontrances et les menaces de son supérieur. Rien n’y fait. Tenace et têtu, notre inspecteur s’accroche, entraînant le lecteur dans une traque haletante relatée avec brio dans un style quasi cinématographique.
Après ce premier galop d’essai, le personnage de Sitwell semble promis à un bel avenir. Gageons aussi que, comme à son habitude, Michael Connelly lui fera rencontrer par la suite ses autres personnages. « Il reviendra certainement, confirme l’auteur dans une interview, et je suis à un stade où je réfléchis à qui je vais le présenter en premier. Haller? Ballard? Bosch? Peut-être McEvoy? Je n’ai pas encore décidé, mais je m’amuse à imaginer toutes les possibilités. »
 « Sous les eaux d’Avalon ». De Michael Connelly. Traduit de l’anglais par Robert Pépin. Calmann-Lévy Noir, 386 p. En librairie le 11 juin 2025.
« Sous les eaux d’Avalon ». De Michael Connelly. Traduit de l’anglais par Robert Pépin. Calmann-Lévy Noir, 386 p. En librairie le 11 juin 2025.
Sur un autre livre de Michael Connelly:
https://polarspolisetcie.com/proces-a-haut-risque-pour-michael-connelly/
Se lancer dans une nouvelle aventure littéraire à 68 ans, voilà qui est plutôt rare et courageux. Après une cinquantaine de polars à succès mettant en scène ses personnages fétiches – le flic Harry Bosch, l’avocat Mickey Haller, l’inspectrice Renée Ballard et le journaliste Jack McEvoy – Michael Connelly change de décor et de héros. […]
Ecrivain aussi passionné que passionnant, Keith McCafferty a grandi dans les Appalaches. Son amour de la pêche à la mouche l’a toutefois conduit dans le Montana où il est devenu rédacteur en chef du magazine de vie au grand air Field & Stream. Le Montana sert aussi de décor et d’ancrage à ses romans, des polars mettant en scène le couple parfois explosif mais efficace formé par la shérif Martha Ettinger et son ami-amant Sean Stranahan aquarelliste, guide de pêche et détective privé à ses heures.
Sixième enquête du duo, « La rivière au cœur froid » démarre sur un fait divers tragique. Prise dans une tempête de neige, une femme meurt de froid dans la montagne, en plein mois d’avril. Pour tenter de s’en sortir, Freida avait rampé jusque dans la tanière d’un grizzli. Se sentant coupable d’avoir entraîné son épouse dans cette équipée mal préparée, son mari se suicide. Peu après, les enquêteurs découvrent dans les affaires abandonnées du couple une boîte à mouches de pêche inhabituelle. Il s’agit d' »une sorte de portefeuille en cuir, à fermeture éclair et doublé en peau de mouton » sur lequel sont estampillées à la pyrogravure les initiales EH. EH comme Ernest Hemingway, devine aussitôt le lecteur qui a lu la quatrième de couverture du livre.
Changement de ton, changement de registre. Un homme – le frère de Freida – est retrouvé mort dans une rivière. Accident ou meurtre? Le doute subsiste. Puis c’est au tour de la femme qui a découvert son cadavre d’être assassinée. Or ces deux victimes avaient, elles aussi, un lien avec Hemingway, plus particulièrement avec une mystérieuse malle de pêche qui lui appartenait et qui aurait été volée, ou perdue, lors d’un transport en train vers l’Idaho, en 1940. Une malle dont une luxueuse canne en bambou refendu s’est brusquement retrouvée sur le marché. Une malle qui, peut-être, contenait aussi un manuscrit inachevé.
Pour écrire ce roman, Keith Mc Cafferty s’est inspiré d’un fait réel. Une anecdote que lui a rapporté Jack Hemingway, le fils du célèbre écrivain. Ce livre est donc une forme d’hommage. Comme à son habitude, l’auteur puise également dans les rudes et magnifiques paysages du Montana pour nourrir, et littéralement enrober, l’enquête de la shérif Martha Ettinger et de son adjoint. Bravant les frontières, et parfois l’éthique policière, ce dernier multiplie les défis et les prises de risque. Dans sa zigzagante chasse au trésor, à la recherche d’un vieil homme un peu fou – un admirateur absolu d’Hemingway, il nous emmène crapahuter sur les eaux gelées du Froze-to-Death Lake, puis déguster un cocktail dans un bar animé de La Havane.
« La rivière au cœur froid » est un roman profus, touffu qui multiple les rebondissements, les sauts, les personnages. Il ignore la logique ordinaire, multiplie les retours en arrière et défie la hiérarchie des faits. L’enquête permet aussi à l’auteur de nous offrir une magnifique galerie de portraits haut en couleur. Et d’irrésistibles descriptions de rivières. De quoi donner des envies de pêche à la mouche même aux lecteurs les plus réfractaires à ce sport.
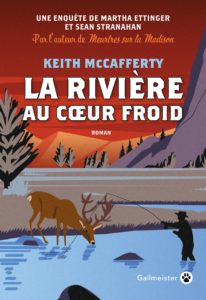 « La rivière au cœur froid ». De Keith McCafferty. Traduit de l’anglais par Marc Boulet. Gallmeister, 480 p.
« La rivière au cœur froid ». De Keith McCafferty. Traduit de l’anglais par Marc Boulet. Gallmeister, 480 p.
Sur d’autres livres de Keith McCafferty:
https://polarspolisetcie.com/les-cheminees-peuvent-etre-mortelles-avis-au-pere-noel/
https://polarspolisetcie.com/des-bisons-une-sherif-intrepide-et-une-irresistible-sirene/
Ecrivain aussi passionné que passionnant, Keith McCafferty a grandi dans les Appalaches. Son amour de la pêche à la mouche l’a toutefois conduit dans le Montana où il est devenu rédacteur en chef du magazine de vie au grand air Field & Stream. Le Montana sert aussi de décor et d’ancrage à ses romans, des […]
A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.
Photo: Lara Schütz





