- mars 22, 2024
- Aucun commentaire
- Asie, Polars
Des tensions interreligieuses en Inde ? Des affrontements sanglants entre communautés indoues et musulmanes ? Voilà qui semble parfaitement d’actualité. « Les ombres de Bombay », cinquième polar de l’excellent Abir Mukherjee, s’ancre pourtant dans un passé déjà lointain. Son intrigue nous transporte au début des années 1920, dans une époque où l’Inde vivait encore sous domination britannique. Une période pleine d’effervescence et grosse de bouleversements à venir qu’il a choisie pour servir de cadre inspirant à une série de polars passionnants, pleins d’humour, d’ironie, et parfaitement documentés. Quand Abir Mukherjee décrit l’effervescence d’une gare surpeuplée, le parfum et la couleur d’une rue ou la colère dévastatrice des Bengalis lorsqu’ils perdent leur sang-froid, on peut lui faire confiance. Il parle, ou plutôt il écrit, en connaissance de cause.
Abir Mukherjee est né en 1974 à Londres dans une famille d’origine indienne. Il a grandi dans l’Ouest de l’Ecosse, étudié l’économie puis travaillé dans la finance avant de se lancer dans l’écriture. Son premier roman, « L’Attaque du Calcutta-Darjeeling » a reçu le Prix Le Point du polar européen 2020. On y faisait la connaissance d’un tandem d’enquêteurs de haut vol, relié par une grande estime réciproque et soudé par une amitié indéfectible : le capitaine Sam Wyndham, un Ecossais bon teint, ancien inspecteur de Scotland Yard, et le sergent indien Satyendra Banerjee, issu d’une bonne famille indienne de Calcutta.
De Calcutta à Bombay par la terre, l’eau et les airs
« Les ombres de Bombay » s’ouvre sur une catastrophe annoncée : l’assassinat, dans un quartier musulman de Calcutta, d’un célèbre homme de lettre hindou. Nous sommes en 1923, Gandhi est en prison, les tensions entre communautés religieuses sont à leur comble. Pour éviter que cet acte ne mette le feu aux poudres, Satyendra Barnejee essaie d’étouffer l’affaire et, ironie du sort, se voit lui-même accusé du meurtre. Risquant la peine de mort, il s’enfuit et tente de découvrir, seul, le véritable assassin. Informé entre temps de la catastrophe, Sam Wyndham va tout faire pour l’aider, mais il doit d’abord le retrouver.
Pour mieux traduire la tension extrême qui traverse le livre de part en part, l’auteur donne alternativement la parole à l’un et l’autre policier, jouant ainsi habilement avec la différence des points de vue et la façon de chacun de s’exprimer. Utilisant le train, le bateau, la voiture, puis l’avion, Bernerjee – rejoint par Wyndham – finit par atterrir à Bombay, d’où venait apparemment le commanditaire. Une ville « à bien des égards plus étrange que l’Angleterre » pour un Bengali. Sans argent, sans soutien officiel, la tâche du tandem s’annonce toutefois quasi désespérée. Deux dames de la bonne société, libres, riches et courageuses, vont leur être d’un précieux secours.
Abir Mukerjee fait partie des nombreux et prestigieux invités de la 20e édition du Festival Quais du polar qui se tient à Lyon du 5 au 7 avril 2024. http://www.quaisdupolar.com
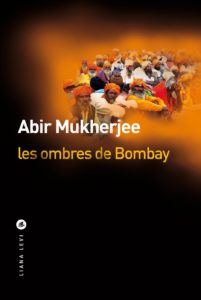 « Les ombres de Bombay ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Emmanuelle et Philippe Aronson. Editions Liana Levi, 368p.
« Les ombres de Bombay ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Emmanuelle et Philippe Aronson. Editions Liana Levi, 368p.
Des tensions interreligieuses en Inde ? Des affrontements sanglants entre communautés indoues et musulmanes ? Voilà qui semble parfaitement d’actualité. « Les ombres de Bombay », cinquième polar de l’excellent Abir Mukherjee, s’ancre pourtant dans un passé déjà lointain. Son intrigue nous transporte au début des années 1920, dans une époque où l’Inde vivait encore sous domination britannique. Une […]
- juin 19, 2023
- Aucun commentaire
- Asie, Polars
Peu de romanciers se sont emparés du Covid. Une relative amnésie qui redouble l’intérêt du dernier polar de Qiu Xiaolong, « Amour, meurtre et pandémie ». Non content de redonner travail et respectabilité à son désormais ex-inspecteur principal Chen Cao, l’écrivain nous plonge dans l’indicible horreur d’une Chine soumise, contre vents et marées, à l’implacable politique du zéro Covid. L’auteur dédie d’ailleurs son livre à tous ceux « qui ont souffert de la pandémie ». En précisant : « La longue liste des victimes inclut mon mentor, le professeur Li Wenjun.»
Un regard percutant sur la Chine
Rappelons que Qiu Xiaolong, qui vit aujourd’hui aux Etats-Unis et écrit en anglais, est né à Shanghai en 1953. Alors que son père, professeur, était victime des brimades des gardes rouges, il fut lui-même interdit de cours durant la révolution culturelle. Ces obstacles ne l’ont pas empêché d’apprendre l’anglais, et de se passionnner pour le poète T.S. Eliot auquel il a consacré sa thèse. Parti poursuivre ses études aux Etats-Unis en 1988, Qiu Xiaolong choisit d’y rester quand éclatent les événements de Tiananmen. Cette distance géographique et la mise en perspective du polar lui permettent ainsi, depuis plus de vingt ans, de poser un regard indépendant, percutant et lucide sur ce pays cher à son cœur dont il décrit l’évolution et les dérives livre après livre.
Quand démarre « Amour, meurtre et pandémie », le policier poète Chen Cao est « en congé de convalescence ». Sanctionné par ses supérieurs, il a par ailleurs été relégué à un poste purement formel à la tête de la réforme du système judiciaire. Alors que le Covid s’étend de jour en jour, il se promène dans une ville désertée, suivant des yeux l’incessant ballet des ambulances et des voitures en route pour l’hôpital. Il n’en oublie pas pour autant de faire un saut au Pavillon de l’abricotier en fleurs pour acheter « des brioches fourrées au porc grillé et des raviolis aux crevettes et au porc », l’un des mets préférés de sa mère. Fin gourmet il fut, fin gourmet il reste même en temps de crise.
Les trois meurtres de l’hôpital Renji
De retour chez lui, et alors qu’il reçoit la visite de sa jeune, charmante et visiblement très amoureuse assistante Jin, Chen Cao voit débarquer sans prévenir le directeur du personnel de la municipalité de Shanghai, Hou. Cet officiel du Parti, qui se déplace dans une prestigieuse voiture Drapeau rouge, vient requérir son aide dans « une grave affaire de meurtres en série », trois cadavres retrouvés à proximité de l’hôpital Renji. Sa requête s’apparente à un ordre. Chen doit s’y soumettre sans tarder, efficacement secondé par Jin.
Parallèlement à son enquête, notre légendaire inspecteur reçoit par Internet des petits textes d’un ami écrivain de Wuhan. Ces billets glaçants parlent de gens qui meurent emmurés dans leur appartement, de femmes enceintes et d’enfants en bas âge qui décèdent dans l’ambulance ou devant l’hôpital faute de pouvoir produire un test Covid négatif de moins de 24 heures. Ils témoignent aussi de la répression qui frappe sans pitié tous ceux qui se révoltent contre les ordres du Parti.
Ces récits – désignés comme « Le Dossier Wuhan » – vont alimenter l’enquête de Chen, et contribuer à sa découverte de la vérité. Car bien entendu notre policier finira par démasquer le – ou les – coupable. Il se verra toutefois contraint de dissimuler la réalité des faits à ses concitoyens afin de ne pas porter préjudice à la politique sanitaire aberrante du gouvernement. Cet interdit ne fera que renforcer sa résolution de tenter de publier hors de Chine le contenu du « Dossier de Wuhan ». Quitte à tromper la censure en traduisant les textes en anglais et en les plaçant sous la couverture d’un recueil de poésie classique.

« Amour, meurtre et pandémie ». De Qiu Xiaolong. Traduit de l’anglais par Françoise Bouillot. Liana Levi, 224 p.
Peu de romanciers se sont emparés du Covid. Une relative amnésie qui redouble l’intérêt du dernier polar de Qiu Xiaolong, « Amour, meurtre et pandémie ». Non content de redonner travail et respectabilité à son désormais ex-inspecteur principal Chen Cao, l’écrivain nous plonge dans l’indicible horreur d’une Chine soumise, contre vents et marées, à l’implacable politique du […]
- juin 1, 2023
- Aucun commentaire
- Asie, Polars
A quoi ressemblait une cure de désintoxication dans l’Inde des années 1920 ? L’écrivain britannique Abir Mukherjee nous en donne un saisissant aperçu dans son nouveau polar, « Le soleil rouge de l’Assam ». Entre potions abominables et vomissements à répétition, le traitement semble des plus rudes. Pas de quoi décourager le vaillant capitaine Sam Wyndham dont le lecteur a suivi, au fil des précédents livres de l’auteur, la chute lente, mais inexorable, dans la dépendance à l’opium.
Traumatisé par la première Guerre Mondiale et par la mort de sa femme, cet ancien de Scotland Yard en poste à Calcutta croyait avoir trouvé dans la drogue de quoi soulager son âme et retrouver le sommeil. Il lui devient toutefois de plus en plus difficile de cacher son addiction. Sur les conseils de son médecin, il se rend dans les collines de Cachar, au fin fond de la province de l’Assam, dans un ashram dirigé «par un saint homme du nom de Devrah Swami ».
Un terrifiant fantôme
Mais à peine arrivé à destination, après un long voyage torturé par le manque, voilà Wyndham brusquement rattrapé par son passé. « C’est arrivé sur le quai. Comme un coup de tonnerre. Une décharge électrique de terreur. Le temps d’un battement de cœur j’ai croisé un fantôme, un mort, un homme que j’ai vu pour la dernière fois il y a presque vingt ans », suffoque-t-il. Or ce visage, cette silhouette sont ceux de Jeremiah Caine qui, autrefois à Londres, avait essayé de le tuer. Réalité ? Hallucination ? Pour le découvrir le lecteur va devoir patienter, car Abir Mukherjee sait à merveille ménager surprises et suspense. L’occasion, entre autres, de nous proposer sa propre version, passablement sophistiquée, du classique mystère de la chambre close.
Et comme toujours, c’est avec une prose élégante et un humour subtil qu’Abir Mukherjee, parfaitement documenté, ressuscite cette période de l’histoire qui le fascine. Lui-même issu d’une famille d’émigrés, il n’a pas son pareil pour évoquer le regard dubitatif de l’adjoint indien de Wyndham « examinant les entrailles gélatineuses d’une crème caramel insipide ». Pour l’auteur, ce roman est aussi, surtout peut-être, une façon « d’écrire sur l’espoir » en dénonçant le racisme, l’intolérance et la peur de l’autre qui gangrènent et empoisonnent nos sociétés.

« Le soleil rouge de l’Assam ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Fanchita Gonzalez Batlle. Liana Levi, 414 p.
A quoi ressemblait une cure de désintoxication dans l’Inde des années 1920 ? L’écrivain britannique Abir Mukherjee nous en donne un saisissant aperçu dans son nouveau polar, « Le soleil rouge de l’Assam ». Entre potions abominables et vomissements à répétition, le traitement semble des plus rudes. Pas de quoi décourager le vaillant capitaine Sam Wyndham dont le […]
- décembre 6, 2022
- Un commentaire
- (Auto)biographies, Asie, Europe
J’aime les pas de côté. Une liberté que je m’arroge volontiers jusque dans ce blog censé prioritairement s’intéresser au polar, mais plus largement placé sous le signe généreux de la ville, de l’architecture et du regard sur le monde. Cette élasticité me permet de vous parler aujourd’hui d’un livre magnifique d’Orhan Pamuk – Prix Nobel de littérature 2006 – « Souvenirs des montagnes au loin ». Hors genres et catégories, cet ouvrage élégant propose une sélection de 200 doubles pages reproduites en fac-similé et tirées des carnets dessinés que l’écrivain turc tient depuis plus de dix ans. Relevons que ce livre est publié en avant-première en France. « En France et chez Gallimard, parce que c’est Gallimard qui a inventé la publication des journaux d’écrivains vivants, avec le « Journal » de Gide, qui reste le journal le plus célèbre », précise l’auteur dans une interview publiée sur le site de son éditeur. Précisons aussi qu’Orhan Pamuk a aujourd’hui 70 ans, l’âge de Gide à l’époque.
La peinture, un premier amour
L’attachement d’Orhan Pamuk aux arts visuels est connu. Il a souvent raconté comment, entre sept et vingt-deux ans, il pensait devenir peintre, avant d’étudier l’architecture et le journalisme, puis d’opter pour l’écriture. Cette passion fut aussi relayée, en 2012, par la création, à Istanbul, du Musée de l’innocence, conçu parallèlement à l’écriture d’un roman éponyme en forme de miroir.
« Souvenirs de la montagne au loin », lui, relève du journal et non de la fiction. Il s’agit d’un curieux projet « bilingue » puisque tout entier consacré au « bonheur de recouvrir un dessin de texte » – texte à son tour traduit ici en français. L’écrivain y évoque sa ville d’Istanbul, ses voyages, ses séjours aux Etats-Unis ou en Inde, ses rêves nocturnes, parfois le menu de ses repas, ses baignades, ses doutes et son travail d’écrivain, ses agacements quotidiens. L’image, essentiellement des paysages, ne se contente jamais d’illustrer son propos. A l’inverse, les mots et les lettres acquièrent une vie propre, une dimension esthétique en soi.
Une irrépressible frénésie de remplissage
Ces feuillets saturés de traits et de signes emmènent le lecteur dans un espace incertain qui tient à la fois de la scène de théâtre et de l’écran de cinéma, deux rectangles accolés où l’image et le texte – un peu comme dans l’art brut – cohabitent, s’ignorent, se fondent et parfois s’entredévorent comme saisis par une irrépressible frénésie de remplissage. Dans l’interview de Gallimard, Orhan Pamuk précisait aussi que ce journal a toujours été pensé dans la perspective d’une possible publication. « Je suis un auteur conscient de moi-même, précise-t-il. Je n’ai pas voulu d’un journal qui soit des mémoires ou une confession, j’ai voulu faire de ces pages un espace artistique. » Cela ne l’empêche pas d’évoquer son « programme habituel de nage », une terrible douleur à l’oreille, la prise d’un somnifère pour calmer ses « peurs existentielles les plus profondes » ou la beauté et la tendresse de sa compagne Asli Akyavas, devenue en avril 2022 sa deuxième épouse.
Illustration: ©2022, Orhan Pamuk, tous droits réservés
 « Souvenirs des montagnes au loin ». Carnets dessinés d’Orhan Pamuk. Traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes. Gallimard, 392 p.
« Souvenirs des montagnes au loin ». Carnets dessinés d’Orhan Pamuk. Traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes. Gallimard, 392 p.
J’aime les pas de côté. Une liberté que je m’arroge volontiers jusque dans ce blog censé prioritairement s’intéresser au polar, mais plus largement placé sous le signe généreux de la ville, de l’architecture et du regard sur le monde. Cette élasticité me permet de vous parler aujourd’hui d’un livre magnifique d’Orhan Pamuk – Prix Nobel […]
- mai 10, 2022
- Aucun commentaire
- Asie, Polars
Est-ce dû à la structure de la pensée et de la langue coréennes? A une façon un peu différente de concevoir la logique, l’espace et le temps? Nous nous garderons bien de trancher. Mais une chose est sûre. « Mortel motel » de Do Jinki est un polar imprévisible et différent. Il s’apparente à une forêt clairsemée dont les arbres bas s’ordonneraient en bouquets ne révélant leur unité profonde et leur vraie nature de forêt que dans un second temps. L’enquête et la « vraie vie » s’y côtoient, le présent et le passé s’y mêlent, il arrive même que les personnages changent d’identité. Le tout pimenté d’une pointe de fantastique et de quelques frissons d’effroi. On se régale.
L’auteur, Do Jinki, 49 ans, est juge au tribunal de Séoul. Il écrit des polars depuis une dizaine d’année et fait à l’évidence profiter son enquêteur Gojin de son savoir et de son expérience. Gojin lui-même était juge, avant d’abandonner quatre ans plus tôt ses fonctions pour devenir une sorte d’avocat de l’ombre qui « traite ses affaires à l’abri des regards et tente de les résoudre à sa façon, en utilisant les failles obscures de la loi plutôt que les procédures officielles ». Il fait équipe avec Lee Yuhyeon, le chef de la brigade criminelle du commissariat de Seocho (un arrondissement de Séoul), un policier apparemment tout ce qu’il y a de plus classique et qui vient d’être nommé au grade de capitaine. Il est doté d’épais sourcils dominant un visage taillé au couteau. Une description physique qui, comme d’autres portraits du roman, se révèle fort intéressante dans ce qu’elle nous dit de la Corée, de ses critères esthétiques, de sa culture.
Meurtre dans un motel
Mais passons aux choses sérieuses, à l’intrigue proprement dite! En l’occurrence, le meurtre d’une jeune femme dans un motel. L’assassinat s’est produit quasiment sous les yeux de Goji, qui s’était arrêté là pour passer la nuit à cause d’une panne de voiture. Très vite, l’affaire s’avère liée aux pratiques peu orthodoxes d’un certaine docteur Yi Tak-o qui dirige à Séoul un Centre de recherches sur le suicide mental. Ce neuro-psychiatre – un homme aux cheveux tout blancs aussi séduisant que manipulateur – propose à tous ceux dont la vie est un enfer, mais qui n’osent se donner la mort, une autre façon de mettre fin à leurs souffrances.
Cet homme, l’avocat Gojin le connaît bien. Il l’a croisé dans une précédente affaire de meurtre déguisée en accident. Le praticien aurait, pense-t-il, machiavéliquement suggéré à une jeune femme malheureuse en ménage du tuer son mari en le faisant tomber d’une falaise. Rien n’avait pu être prouvé à l’époque. Gojin a donc une revanche à prendre. Et surtout le sentiment que seule la résolution de cette première histoire permettra de vraiment comprendre le meurtre du motel. Le lecteur n’est pas au bout de ses surprises.
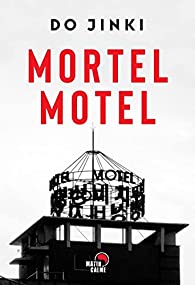
« Mortel motel ». De Do Jinki. Traduit du coréen par Lim Yeong-hee et Mathilde Colo. Matin calme éditions, 334 p.*
*Cette nouvelle maison d’édition publie depuis 2020 des polars coréens. Un choix motivé par la richesse de tout un pan de la littérature coréenne jusqu’alors peu ou pas traduit en français. Matin calme affiche aujourd’hui à son catalogue une vingtaine de titres, dont un autre polar de Do Jinki, « Le portrait de la Traviata ».
Est-ce dû à la structure de la pensée et de la langue coréennes? A une façon un peu différente de concevoir la logique, l’espace et le temps? Nous nous garderons bien de trancher. Mais une chose est sûre. « Mortel motel » de Do Jinki est un polar imprévisible et différent. Il s’apparente à une forêt clairsemée […]
- novembre 23, 2021
- 2 commentaires
- Asie, Polars
Dina Kaminer a été assassinée. On l’a découverte attachée à une chaise dans son salon, le mot « maman » gravé sur le front, une poupée serrée entre ses doigts. Les journaux se sont généreusement épanchés sur le drame. Ils ont rappelé que cette brillante quadragénaire était titulaire d’un doctorat en études de genre et qu’elle était notamment l’auteure d’un article sur les femmes stériles dans la Bible. Ils n’ont pas omis de mentionner qu’elle-même avait choisi de rester célibataire sans enfants, s’affirmant ainsi comme la cheffe de file d’un courant très controversé en Israël.
Dina est-elle morte à cause de son refus d’enfanter? C’est ce que nous suggère fort habilement Sarah Blau – l’une des voix montantes de la scène littéraire féministe israélienne – dans les premières pages de son polar « Filles de Lilith ». Quand ensuite le cadavre de Ronit, elle aussi célibataire sans enfant, est retrouvée dans une mise en scène similaire, l’idée d’un tueur en série se profile. Et l’on commence à craindre pour la narratrice, l’attachante et tourmentée Sheila Heller. Cette dernière avait été très proche des deux victimes durant ses études. Elle partage toujours leurs idées mais semble désormais surtout éprouver haine et jalousie à leur égard. Ses jours sont-ils comptés? Sheila elle-même nous rassure: « Si je suis le détective de cette histoire, j’ai au moins la certitude de rester en vie jusqu’à la dernière page. »
L’ombre de la sulfureuse Lilith
Des clins d’œil, de l’ironie, de l’autodérision, on en trouve à foison dans ce déroutant polar. Une mise à distance du suspense et de l’intrigue qui n’empêche pas l’auteure d’éprouver une indéniable tendresse pour ses personnages. Prenez Sheila qui tente non sans peine de concilier ses presque quarante-deux ans et son attirance pour les jeunes hommes. Tout en pestant contre ses muscles faciaux qui se relâchent et sa peau qui se dessèche, elle travaille comme conférencière au musée de la Bible où trône une collection de figurines représentant aussi bien Jacob qu’Abraham, Sarah ou Hagar. La sculpture de la sulfureuse Lilith chère aux féministes, et dont l’ombre plane sur ce récit, en a été bannie. Une femme grande, imposante, poilue et nue plantant « ses dents dans un nouveau-né, tel un prédateur vorace », cela n’aurait pas été très casher!
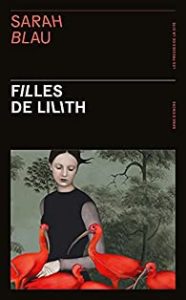 « Filles de Lilith ». De Sarah Blau. Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen. Les Presses de la Cité, 252 p.
« Filles de Lilith ». De Sarah Blau. Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen. Les Presses de la Cité, 252 p.
Dina Kaminer a été assassinée. On l’a découverte attachée à une chaise dans son salon, le mot « maman » gravé sur le front, une poupée serrée entre ses doigts. Les journaux se sont généreusement épanchés sur le drame. Ils ont rappelé que cette brillante quadragénaire était titulaire d’un doctorat en études de genre et qu’elle était […]
A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.
Photo: Lara Schütz





