« Le Mal. Chant de D’arco I » d’Antonio Moresco est une rareté, un vrai délice de liberté et d’inventivité créatrice. Ce thriller métaphysique – comme le désigne la critique – présente toutefois quelques faiblesses. Après un départ flamboyant, le récit par moments s’enlise dans une logorrhée répétitive et obsessionnelle qui frise la saturation. On tutoie l’ennui. Dans la dernière partie, heureusement, l’auteur retrouve son punch, renoue avec l’urgence et l’incandescence du début. Ces quelques « défauts » n’entament donc pas l’intérêt de ce roman, la première incursion dans le noir d’un des grands auteurs italiens contemporains, un écrivain qui, né en 1947 à Mantoue, a connu dans sa jeunesse aussi bien le séminaire que la lutte révolutionnaire.
Premier volet d’une trilogie, « Le Mal » commence par une révélation choc du personnage principal: « Je m’appelle D’Arco et je suis un flic mort. » Détail aggravant, et passablement déconcertant, notre héros, bien que retraité de la vie, est toujours en poste, « affecté depuis trois ans au commissariat central de la ville des morts ». Malgré son corps couturé de cicatrices et ses yeux devenus blancs, il mène une existence relativement normale dans cette cité hypermoderne et fébrile, une pépinière de rues et de routes hérissée de gratte-ciel, de centres commerciaux et de chantiers. Un environnement calqué sur le nôtre, à une nuance près. S’il l’on prête l’oreille et que l’on sait écouter, on y entend la nuit des voix déchirant le silence, un chant lent et doux comme une berceuse, le chant des enfants morts.
Chargé par un mystérieux personnage de découvrir l’origine et la cause de cette hécatombe d’enfants, D’Arco se lance dans une croisade littéralement donquichottesque. Epaulé par un tout jeune complice devenu muet à la suite des sévices qu’il a subis, il retourne dans la ville des vivants pour tenter d’arrêter le massacre et châtier les coupables. Armé jusqu’aux dents, il multiplie les opérations spectaculaires, mais arrive toujours trop tard. Les enfants sont déjà morts.
« Le Mal » se présente donc comme une parabole, ou un conte, sur le bien, le mal, la vie, la mort, et même l’amour. Avec la complicité du lecteur, Antonio Moresco s’approprie malicieusement les codes du roman noir pour mieux les détourner. Il nous offre ainsi, sur trois pages, la liste de tous les clichés du genre que l’on ne trouvera pas dans son roman, qu’il s’agisse de descriptions minutieuses de l’horreur, du « catalogue des dernières nouveautés en matière de balistique » ou des différents modèles de pistolets-mitrailleurs. Cela n’empêche pas son héros de réclamer au commissariat de la ville des vivants une longue liste d’armes à mettre à sa disposition. Dont une arbalète avec visée infrarouge, un couteau, une dague et … un petit canon.
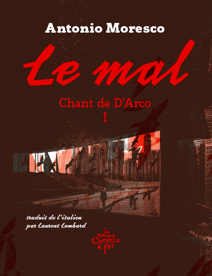 « Le Mal. Chant de D’arco I ». D’Antonio Moresco. Traduit de l’italien par Laurent Lombard. Les éditions du Chemin de fer, 288 p. En librairie le 7 novembre 2025.
« Le Mal. Chant de D’arco I ». D’Antonio Moresco. Traduit de l’italien par Laurent Lombard. Les éditions du Chemin de fer, 288 p. En librairie le 7 novembre 2025.
« Le Mal. Chant de D’arco I » d’Antonio Moresco est une rareté, un vrai délice de liberté et d’inventivité créatrice. Ce thriller métaphysique – comme le désigne la critique – présente toutefois quelques faiblesses. Après un départ flamboyant, le récit par moments s’enlise dans une logorrhée répétitive et obsessionnelle qui frise la saturation. On tutoie l’ennui. […]
Les femmes tiennent rarement les premiers rôles dans les romans d’espionnage. Fan de ce genre éminemment masculin, l’Américaine Anna Pitoniak – alors éditrice chez Random House – s’en désolait. Elle a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’écrire elle-même le livre dont elle rêvait. « L’incident d’Helsinki » est son quatrième roman, mais le premier qui s’aventure véritablement dans l’univers des identités troubles et des trahisons institutionnalisées. Il s’articule autour du personnage riche et parfois douloureux d’Amanda Cole, une jeune et brillante espionne, elle-même fille d’espion. L’auteure en profite pour nous rappeler que, dans ce monde très particulier, la guerre froide n’a, de fait, jamais pris fin.
Dans la vie d’un agent secret, il existe des situations particulièrement stressantes. Par exemple d’apprendre, par le biais d’un transfuge, l’assassinat imminent d’un homme politique représentant son pays sans rien pouvoir faire pour l’empêcher. Travaillant à Rome comme adjointe du chef de poste de la CIA, Amanda Cole, 40 ans, se serait bien passé d’une telle expérience qui, outre son professionnalisme, va mettre à l’épreuve ses certitudes et ébranler les fondements même de son existence.
Un mystérieux visiteur
Bref! Voici ce qui s’est passé. Par une chaude et paisible journée de juillet, un homme bouleversé se présente à la porte de l’ambassade des Etats-Unis. Il est Russe. Il s’appelle Konstantin Semonov et – on l’apprend très vite – il travaille pour le GRU, la Direction générale du renseignement. Il annonce à Amanda – alors seule au bureau – que le sénateur américain Robert Vogel, en visite officielle au Caire, va être victime d’un AVC mortel le lendemain, en assistant à une parade militaire.
Semonov n’a bien sûr rien d’un devin. Sans révéler ses sources, il ajoute, espérant ainsi convaincre son interlocutrice: « Il existe des substances chimiques qui déclenchent dans le corps humain des symptômes très semblables à ceux d’un AVC. Si semblables qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute la conclusion du médecin. Surtout quand la personne décédée a quatre-vingts ans et une santé fragile. »
Info ou intox? Amanda balance. Elle en réfère aussitôt à son supérieur, qui la prend pour une folle et lui intime de ne pas réagir. Et le lendemain, Vogel meurt, comme annoncé. Taraudée par le remord, Amanda retrouve Semonov encore à Rome et commence à enquêter. Grâce à des papiers retrouvés chez le sénateur Vogel, elle apprend qu’il avait été informé par un riche oligarque de certaines manipulations financières permettant à la Russie de prendre le contrôle de puissantes entreprises étrangères. Dans la foulée, elle découvre dans ces notes lapidaires le nom de Charlie Cole, son propre père, un espion chevronné désormais retraité.
Sidération! Panique! Amanda va-t-elle flancher devant la vérité qu’elle pressent ou poursuivre son enquête jusqu’au bout de l’effroi? Mixant habilement les points de vue grâce à ses différents personnages, émaillant son récit de multiples flash-back, l’écrivaine Anna Pitoniak dénoue fil après fil le nœud d’une trahison qui eut pour cadre l’île de Särkkä, près d’Helsinki. Et pour contexte la fin des années 1980 dans une Finlande toujours sous l’emprise de son puissant voisin russe.
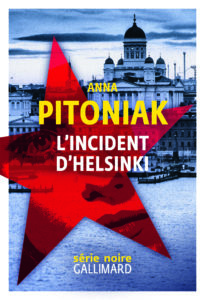 « L’incident d’Helsinki ». D’Anna Pitoniak. Traduit de l’anglais par Jean Esch. Gallimard, Série noire, 424 p.
« L’incident d’Helsinki ». D’Anna Pitoniak. Traduit de l’anglais par Jean Esch. Gallimard, Série noire, 424 p.
Les femmes tiennent rarement les premiers rôles dans les romans d’espionnage. Fan de ce genre éminemment masculin, l’Américaine Anna Pitoniak – alors éditrice chez Random House – s’en désolait. Elle a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’écrire elle-même le livre dont elle rêvait. « L’incident d’Helsinki » est son quatrième roman, mais […]
J’adore les polars du Norvégien Jørn Lier Horst. Je les préfère toutefois écrits à deux plutôt qu’à quatre mains. Bien qu’un peu sec, privilégiant avant tout la dynamique et l’efficacité des dialogues, « Faux-semblant », son deuxième roman cosigné avec le journaliste Thomas Enger, reste fort bon. Il s’avère même par moments virtuose dans l’art de brouiller les pistes, de rebondir et de surprendre. On y retrouve les deux fins limiers apparus dans « Que le meilleur gagne », le premier épisode de cette nouvelle série: l’inspecteur Alex Blix et la jeune journaliste Emma Ramm. Deux êtres discrètement complices que relie un tragique épisode de leur passé commun.
« Faux-semblant » commence comme se terminait le roman précédent, par un compte à rebours. Un événement banal en l’occurrence, celui qui précède l’entrée dans la nouvelle année. Emma n’en est pas moins animée par un terrible pressentiment. Quittant ses proches et le réveillon, elle se rend seule sur la place de l’hôtel de ville où se déroulent les festivités. Et quand minuit arrive, sa crainte se confirme. Parallèlement au feu d’artifice, une terrible explosion survient. La bombe avait été placée dans une poubelle. Bilan: de nombreux blessés et quatre morts, dont Kasper, le compagnon d’Emma.
Appelé en urgence sur les lieux, Blix aperçoit un corps qui flotte dans l’eau du port. Sans hésiter, il plonge dans les flots glacés et ramène à terre une jeune femme inanimée, grièvement blessée. La carte bancaire retrouvée sur elle permet de l’identifier. Elle se nomme Ruth-Kristine Smeplass. Une information qui agit sur Blix comme un électrochoc. Cette femme serait donc la mère de Patricia, la fillette d’un an enlevée dans sa poussette en 2009. Elle ne fut jamais retrouvée, pas plus que son ravisseur.
Pas une minute à perdre. Alors que la police privilégie la piste terroriste, Blix rouvre le dossier, réinterroge les témoins et les proches, constatant dans la foulée que certains ont brusquement et mystérieusement disparu. Bouleversée par la perte de son compagnon, Emma elle aussi se jette à corps perdu dans l’enquête et parvient à remonter la piste des coupables dans le sillage du policier. Pour l’un comme pour l’autre, les pièces du puzzle peu à peu s’assemblent tandis que se multiplient retournements et coups de théâtre. Patricia est-elle encore en vie? Fort habilement et jusqu’à la fin du roman, les deux auteurs parviennent à nourrir le doute et à entretenir le suspense.
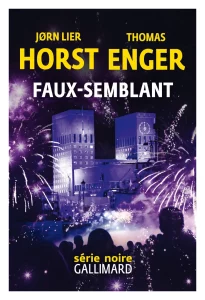 « Faux-semblant ». De Jørn Lier Horst et Thomas Enger. Traduction de Marie-Caroline Aubert. Gallimard, Série noire, 416 p.
« Faux-semblant ». De Jørn Lier Horst et Thomas Enger. Traduction de Marie-Caroline Aubert. Gallimard, Série noire, 416 p.
Sur « Que le meilleur gagne », qui sort parallèlement en poche: https://polarspolisetcie.com/un-machiavelique-compte-a-rebours/
J’adore les polars du Norvégien Jørn Lier Horst. Je les préfère toutefois écrits à deux plutôt qu’à quatre mains. Bien qu’un peu sec, privilégiant avant tout la dynamique et l’efficacité des dialogues, « Faux-semblant », son deuxième roman cosigné avec le journaliste Thomas Enger, reste fort bon. Il s’avère même par moments virtuose dans l’art de brouiller […]
L’immédiat après-guerre a décidément la cote au royaume du polar. Dans cette profusion de nouvelles parutions, dont certaines excellentes, « Nuit et Brouillard » d’Yves Fougères occupe une place à part. Lauréat du prix du Quai des Orfèvres en… 1948, l’année de sa parution, ce roman nous révèle en effet ce que pouvait voir, savoir, et imaginer un homme de 27 ans contemporain des faits.
De son vrai nom Yves Le Souchu, Yves Fougères naît en 1921 à Bordeaux – il meurt très jeune, en1953, à Rions. Se consacrant à la littérature après des études d’histoire, il est l’auteur de plusieurs pièces de théâtre, de nouvelles et de romans. Témoignant d’un vrai talent tant au niveau dramaturgique que styliste, « Nuit et Brouillard » – le nom de code du décret nazi ordonnant la déportation, dans le plus grand secret, de tous les opposants ou ennemis du Troisième Reich – en est le plus célèbre. Ce roman d’espionnage n’avait plus été réédité depuis l’après-guerre. C’est désormais chose faite grâce aux Nouveau Monde éditions. Une des bonnes surprises de la rentrée.
Complexe dans sa construction comme dans son propos, « Nuit et Brouillard » commence le 16 mars 1946. Il démarre avec le récit du lieutenant Karl Weber, un ancien SS qui parvient à s’évader d’une prison française en compagnie de trois autres nazis. A ce premier récit s’ajoute et se mêle un second, celui du lieutenant français Prieur. Envoyé par les services secrets à Freiburg, en Allemagne, il est chargé d’enquêter sur la disparition et le meurtre de deux agents, tout en aidant ses collègues à surveiller Weber. Se faisant passer pour un journaliste censé effectuer un reportage dans la région, Prieur découvre qu’une boîte de nuit locale, la Lune bleue, sert de couverture à un réseau de nostalgiques du Troisième Reich. Des hommes cyniques et sans scrupules bien résolus à rétablir par la force l’ordre ancien en exhortant notamment le peuple allemand à reprendre les armes. Dans ce nid de vipères où chacun dissimule sa véritable identité, il devient de plus en plus difficile de distinguer ses amis de ses ennemis. Le lieutenant Prieur parviendra-t-il à sauver sa peau? Rien n’est moins sûr.
Rappelant que la paix ne se fait pas en un jour et que l’infamie peut, si l’on n’y prend garde, renaître à tout moment de ses cendres, « Nuit et Brouillard » est un roman sombre et lucide. Chez Yves Fougères, le noir se teinte toutefois d’ironie et d’humour. L’auteur se moque ainsi gentiment d’un article rédigé par Prieur: « Beaucoup de généralités. Ce n’était peut-être pas transcendant, mais c’était du journalisme courant. » Il nous offre enfin de très belles descriptions de personnages et de lieux. Et notamment de ce voyage en train « où les tunnels se succédaient avec des grondements de gouffre et où la fumée s’écoulant dense et morte sur les vitres se condensait en vapeur sale ».
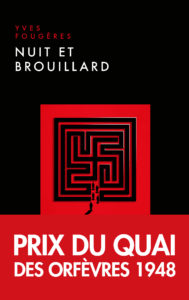 « Nuit et Brouillard ». D’Yves Fougères. Nouveau Monde éditions, coll. Sang-froid, 256 p.
« Nuit et Brouillard ». D’Yves Fougères. Nouveau Monde éditions, coll. Sang-froid, 256 p.
L’immédiat après-guerre a décidément la cote au royaume du polar. Dans cette profusion de nouvelles parutions, dont certaines excellentes, « Nuit et Brouillard » d’Yves Fougères occupe une place à part. Lauréat du prix du Quai des Orfèvres en… 1948, l’année de sa parution, ce roman nous révèle en effet ce que pouvait voir, savoir, et imaginer […]
Toute ville, tout village même le plus modeste peuvent aujourd’hui prétendre servir de décor à un polar. Paris figure toutefois parmi les plus célèbres et les plus courtisées, tant par la littérature que par le cinéma. Journaliste et fin connaisseur de la capitale française, Marc Lemonier lui consacre un petit guide généreux, pratique et largement illustré proposant 32 balades « dans les pas des héros de séries, de films et de romans policiers ». L’ouvrage se divise en sept grands secteurs regroupant de deux à quatre arrondissements. Agrémenté d’une liste de romans, voire de films, à (re)découvrir in situ, chaque chapitre comprend une demi-douzaine de promenades accompagnées de plans.
C’est « Autour du 36 du quai des Orfèvres » et du fameux siège de la P.J. que, tout naturellement, commence le voyage. Après avoir relaté l’histoire littéraire de l’illustre bâtisse, l’auteur nous emmène déjeuner place Dauphine avec Maigret. Au menu: blanquette de veau maison, bien entendu. On imagine ensuite, quai de l’Horloge, les sous-sols censés abriter les activités de la bande de Fantômas, la célébrissime créature de Pierre Souvestre et Marcel Allain, des sous-sols qui, le hasard faisant bien les choses, communiquaient avec le palais de justice. Une halte s’impose ensuite sur l’ancien site de la Morgue, quai du Marché-Neuf-Maurice-Grimaud (elle se trouve aujourd’hui, et depuis 1914, quai de la Rapée). Et ce premier périple peut s’achever 100, rue Réaumur, à l’adresse historique de France-Soir, le quotidien préféré des auteurs de polars pour son goût des gros titres et du sensationnalisme.
Maigret, Nestor Burma, Fantômas ou Arsène Lupin sont les héros récurrents de ces balades policières. Mais Marc Lemonier nous offre aussi des rencontres moins attendues, voire insolites. Un détour ainsi s’impose par la rue Saint-Spire, l’occasion de retrouver Le Sentier d’autrefois à travers les yeux amusés et amoureux de Joseph Bialot dont l’excellent polar « Le Salon du prêt-à-saigner » a été réédité récemment par la Série Noire. Les fans de Fred Vargas, eux, prendront la direction du commissariat du 13e arrondissement, 144, boulevard de l’Hôpital, où vient de s’installer, dans « Pars vite et reviens tard », le sympathique commissaire Adamsberg, toujours rêveur et insaisissable. Et l’on termine en beauté à la Butte-aux-Cailles qui fut le théâtre de l’épisode « Mécomptes d’auteurs » (1987) de la cultissime série policière française « Les cinq dernières minutes ». Un feuilleton télévisé aujourd’hui un peu oublié et qui fut pourtant diffusé pendant …..38 ans.
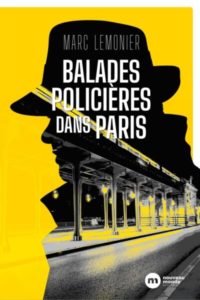 « Balades policières dans Paris ». De Marc Lemonier. Nouveau Monde Editions, 240 p.
« Balades policières dans Paris ». De Marc Lemonier. Nouveau Monde Editions, 240 p.
Toute ville, tout village même le plus modeste peuvent aujourd’hui prétendre servir de décor à un polar. Paris figure toutefois parmi les plus célèbres et les plus courtisées, tant par la littérature que par le cinéma. Journaliste et fin connaisseur de la capitale française, Marc Lemonier lui consacre un petit guide généreux, pratique et largement […]
Trop cruels, trop violents à mon goût, et pas très bien écrits. Jusqu’ici je n’avais pas adhéré aux polars de Piergiorgio Pulixi, pourtant très largement plébiscités par les lecteurs francophones. Avec « Stella », le petit dernier paru en avril dernier, mes réticences ont fondu! Je me suis plongée sans réserve dans l’univers dynamique et coloré de l’écrivain italien. D’emblée, j’ai été convaincue et séduite par son trio d’enquêtrices intrépides, Mara Rais, Eva Croce et Clara Pontecorvo. Trois fortes personnalités féminines épaulées par le ténébreux, séduisant et tourmenté criminologue Vito Strega, un métis à la stature impressionnante débarqué tout exprès de Milan.
S’il ne dédaigne pas la série, Piergiorgio Pulixi n’est pas homme à se répéter. Il aime les variations, aussi bien thématiques que formelles. D’une facture assez classique, ce nouveau polar se déroule presque entièrement à Cagliari – où l’écrivain est né en 1982. La figure centrale du récit, Maristella Coga, dite Stella, 17 ans, est une jeune fille à la beauté insolente et solaire, dotée d’une intelligence aiguisée et têtue. Pour son malheur, elle est née dans une famille disfonctionnelle du quartier populaire et défavorisé de Sant’Elia. Le lecteur n’aura donc pas la chance de la croiser vivante. Son corps au visage affreusement mutilé vient d’être retrouvé « recroquevillé sur les galets d’un lambeau de plage entre le village de pêcheurs et le port industriel de Giorgino: un pan de littoral dénaturé par les gaz d’échappement et les rejets huileux des bateaux de la zone portuaire ».
Voilà pour le décor. Passons aux suspects. Père prétendument incestueux, mère alcoolique et maladivement jalouse, prêtre véreux, petit ami à la tête du trafic de stupéfiants dans le quartier, voire dans la ville, ils sont si nombreux que l’enquête piétine. Emaillant son texte d’expressions et de jurons en sarde – un peu trop systématiquement peut-être – l’auteur en profite pour nous raconter Cagliari, et plus spécifiquement Sant’Elia, un ancien lazaret devenu, après la Seconde Guerre mondiale, le refuge des habitants des quartiers rasés par les bombes. Et le roman se termine comme il se doit par un coup de théâtre! Quant à l’identité de la mystérieuse femme qui, à Milan, traque le criminologue Strega jusque dans son intimité la plus secrète, elle restera à jamais une énigme. A moins que… A moins qu’un prochain roman ne nous en révèle davantage. Avec Piergiorgio Pulixi, toutes les surprises sont possibles.
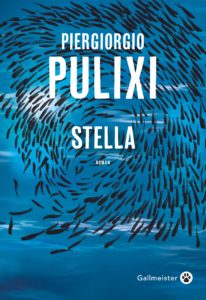 « Stella ». De Piergiorgio Pulixi. Traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux. Gallmeister, 576 p.
« Stella ». De Piergiorgio Pulixi. Traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux. Gallmeister, 576 p.
Trop cruels, trop violents à mon goût, et pas très bien écrits. Jusqu’ici je n’avais pas adhéré aux polars de Piergiorgio Pulixi, pourtant très largement plébiscités par les lecteurs francophones. Avec « Stella », le petit dernier paru en avril dernier, mes réticences ont fondu! Je me suis plongée sans réserve dans l’univers dynamique et coloré de […]
A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.
Photo: Lara Schütz





