Trop cruels, trop violents à mon goût, et pas très bien écrits. Jusqu’ici je n’avais pas adhéré aux polars de Piergiorgio Pulixi, pourtant très largement plébiscités par les lecteurs francophones. Avec « Stella », le petit dernier paru en avril dernier, mes réticences ont fondu! Je me suis plongée sans réserve dans l’univers dynamique et coloré de l’écrivain italien. D’emblée, j’ai été convaincue et séduite par son trio d’enquêtrices intrépides, Mara Rais, Eva Croce et Clara Pontecorvo. Trois fortes personnalités féminines épaulées par le ténébreux, séduisant et tourmenté criminologue Vito Strega, un métis à la stature impressionnante débarqué tout exprès de Milan.
S’il ne dédaigne pas la série, Piergiorgio Pulixi n’est pas homme à se répéter. Il aime les variations, aussi bien thématiques que formelles. D’une facture assez classique, ce nouveau polar se déroule presque entièrement à Cagliari – où l’écrivain est né en 1982. La figure centrale du récit, Maristella Coga, dite Stella, 17 ans, est une jeune fille à la beauté insolente et solaire, dotée d’une intelligence aiguisée et têtue. Pour son malheur, elle est née dans une famille disfonctionnelle du quartier populaire et défavorisé de Sant’Elia. Le lecteur n’aura donc pas la chance de la croiser vivante. Son corps au visage affreusement mutilé vient d’être retrouvé « recroquevillé sur les galets d’un lambeau de plage entre le village de pêcheurs et le port industriel de Giorgino: un pan de littoral dénaturé par les gaz d’échappement et les rejets huileux des bateaux de la zone portuaire ».
Voilà pour le décor. Passons aux suspects. Père prétendument incestueux, mère alcoolique et maladivement jalouse, prêtre véreux, petit ami à la tête du trafic de stupéfiants dans le quartier, voire dans la ville, ils sont si nombreux que l’enquête piétine. Emaillant son texte d’expressions et de jurons en sarde – un peu trop systématiquement peut-être – l’auteur en profite pour nous raconter Cagliari, et plus spécifiquement Sant’Elia, un ancien lazaret devenu, après la Seconde Guerre mondiale, le refuge des habitants des quartiers rasés par les bombes. Et le roman se termine comme il se doit par un coup de théâtre! Quant à l’identité de la mystérieuse femme qui, à Milan, traque le criminologue Strega jusque dans son intimité la plus secrète, elle restera à jamais une énigme. A moins que… A moins qu’un prochain roman ne nous en révèle davantage. Avec Piergiorgio Pulixi, toutes les surprises sont possibles.
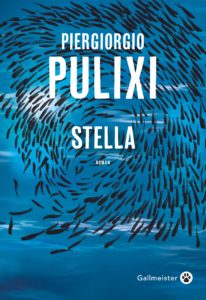 « Stella ». De Piergiorgio Pulixi. Traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux. Gallmeister, 576 p.
« Stella ». De Piergiorgio Pulixi. Traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux. Gallmeister, 576 p.
Trop cruels, trop violents à mon goût, et pas très bien écrits. Jusqu’ici je n’avais pas adhéré aux polars de Piergiorgio Pulixi, pourtant très largement plébiscités par les lecteurs francophones. Avec « Stella », le petit dernier paru en avril dernier, mes réticences ont fondu! Je me suis plongée sans réserve dans l’univers dynamique et coloré de […]
Une grosse surprise, teintée d’un brin de déception, mais vite oubliée. Après cinq enquêtes menées tambour battant par son efficace duo Wyndham-Banerjee, l’Anglais Abir Mukherjee quitte l’Inde – le pays de sa famille – et les années 1920 pour s’installer dans l’Amérique contemporaine. Un désir de changement bien compréhensible. Et qui lui réussit parfaitement. « Les Fugitifs » est un polar palpitant, complexe et superbement construit. Un polar sous tension, né de la colère de l’auteur contre ce qu’il advient du monde.
Le roman se situe à la toute fin d’une élection présidentielle très disputée et dont l’issue s’avère plus qu’incertaine. Face à Greenwood, la vice-présidente démocrate, se dresse avec toute sa morgue et son arrogance un républicain nommé Costa « que la moitié de la population américaine considère comme un cinglé narcissique qui tuerait sa propre mère pour entrer à la Maison Blanche ». Toute ressemblance avec des personnes existantes n’est bien sûr pas fortuite. Mukherjee précise par ailleurs avoir commencé son roman avant l’attaque du Capitole par les partisans de Trump.
Une fois le contexte posé, l’auteur construit librement une intrigue qui fait la part belle à la corruption, au complot et qui se situe d’emblée dans la veine du thriller. Ecrit à la troisième personne et porté par différents narrateurs, le récit commence avec un attentat dans un centre commercial de Los Angeles. Un acte barbare que l’on « vit » aux côtés de la poseuse de bombe, une jeune fille volontairement sacrifiée des commanditaires qui se font appeler « Les Fils du califat ». Un nom parfaitement inconnu des spécialistes du terrorisme!
Aussitôt après l’explosion, prenant des risques considérables, Shreya Mistry, agente spéciale du FBI, se précipite à l’intérieur du bâtiment qui menace de s’effondrer. Impétueuse et indocile, cette jeune femme d’origine indienne retrouve ainsi, par miracle, les vidéos de surveillance où l’on voit la kamikaze courir, sortir son téléphone… et mourir. Pourquoi courait-elle? Avait-elle été piégée? Cet attentat meurtrier n’était-il que le premier d’une série machiavéliquement planifiée avant les élections pour déstabiliser l’Amérique? Hantée par ces questions, ignorant les sanctions et les brimades de sa hiérarchie, Shreya va alors tout mettre en œuvre pour retrouver une jeune femme, Aliyah qui, venue de Londres, était entrée sur le territoire américain en même temps que la poseuse de bombe.
A l’enquête « officielle » se superpose alors une deuxième traque plus discrète. Prévenu que sa fille est en danger, le père d’Aliyah tente de la retrouver avec l’aide d’une Américaine dont le fils, lui aussi disparu, semble pris dans le même engrenage. Et l’auteur profite de cette double course – poursuite pour nous faire traverser les Etats-Unis de part en part. Le chemin des parents éplorés finit par croiser la route de l’agente du FBI. Et le tout se termine dans une monstre bastringue électorale avec mouvements de foule et ambiance survoltée, une apothéose tragique et très cinématographique dont l’auteur a le secret. Glissant de découverte en révélation, ce dernier parvient en outre à nous tenir en haleine jusqu’au bout. Dans « Les Fugitifs », l’identité des traitres et leurs motivations sont en effet susceptibles de changer jusqu’au dernier moment.
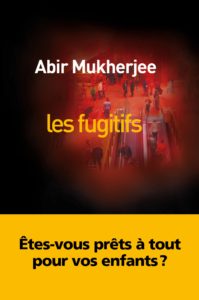 « Les Fugitifs ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Pierre Reignier. Editions Liana Levi, 408 p.
« Les Fugitifs ». D’Abir Mukherjee. Traduit de l’anglais par Pierre Reignier. Editions Liana Levi, 408 p.
Sur d’autres livres d’Abir Mukherjee:
https://polarspolisetcie.com/le-mystere-indien-de-la-chambre-close/
https://polarspolisetcie.com/traque-sans-merci-au-coeur-de-la-poudriere-indienne/
Une grosse surprise, teintée d’un brin de déception, mais vite oubliée. Après cinq enquêtes menées tambour battant par son efficace duo Wyndham-Banerjee, l’Anglais Abir Mukherjee quitte l’Inde – le pays de sa famille – et les années 1920 pour s’installer dans l’Amérique contemporaine. Un désir de changement bien compréhensible. Et qui lui réussit parfaitement. « Les […]
Se lancer dans une nouvelle aventure littéraire à 68 ans, voilà qui est plutôt rare et courageux. Après une cinquantaine de polars à succès mettant en scène ses personnages fétiches – le flic Harry Bosch, l’avocat Mickey Haller, l’inspectrice Renée Ballard et le journaliste Jack McEvoy – Michael Connelly change de décor et de héros. Dans « Sous les eaux d’Avalon », son dernier polar, l’écrivain américain quitte la vie trépidante de Los Angeles pour le cadre idyllique de Santa Catalina, une île rocheuse de 194 km2 située à 35 kilomètres du continent. Et pour nous la faire découvrir, il crée de toutes pièces un nouvel enquêteur, un homme têtu, intègre et courageux, l’inspecteur Stilwell.
Ce parti pris nous permet d’assister en direct à la naissance d’un personnage, à la manière dont ce dernier peu à peu s’ancre dans la fiction. Au départ, on ne sait rien de lui. Ensuite progressivement, comme dans un film, les choses s’éclairent, prennent forme et des repères se mettent en place. La figure de Stilwell se dessine, avec un passé, des sentiments. On découvre notamment qu’il entretient une relation amoureuse stable avec Tash – une nouveauté dans l’univers romanesque de Michael Connelly.
Un cadavre bien gênant découvert sous un bateau
Débarqué de l’unité des Homicides du LAPD (Los Angeles Police Department), Stilwell a atterri à Santa Catalina après une embrouille avec un collègue peu scrupuleux. Il s’agit donc d’un placard, même pas doré, d’une manière de le punir en lui coupant les ailes. « En sa qualité d’inspecteur assigné à Avalon (la ville principale de Santa Catalina, réd.), c’était lui qui commandait les forces de l’île. Cet honneur lui valait tout un tas de tâches de gestion et d’administration qu’il n’acceptait qu’à regret », précise l’auteur.
En temps normal, à part quelques délits mineurs, il ne se passe par grand-chose dans ce paradis protégé pour touriste fortunés. Peu après l’arrivée de Stilwell, toutefois, la situation se dégrade. Outre une histoire de bison mutilé, et en plus de l’agression d’un officier de police dans un bar, notre inspecteur se retrouve avec un cadavre sur les bras. Il s’agit d’une jeune femme à la réputation un brin sulfureuse qui travaillait dans un club privé très sélect. Son corps, enveloppé dans une bâche et lesté, a été retrouvé sous un bateau du port.
En pleine saison touristique, le maire tente d’étouffer l’affaire. Il est aidé par des policiers qui, envoyés du continent, se contentent d’enquêter mollement. Bien qu’officiellement tenu à l’écart, Stilwell ne peut rester inactif. Il part sur les traces du tueur et dénonce les conclusions hâtives de ses collègues, s’attirant les remontrances et les menaces de son supérieur. Rien n’y fait. Tenace et têtu, notre inspecteur s’accroche, entraînant le lecteur dans une traque haletante relatée avec brio dans un style quasi cinématographique.
Après ce premier galop d’essai, le personnage de Sitwell semble promis à un bel avenir. Gageons aussi que, comme à son habitude, Michael Connelly lui fera rencontrer par la suite ses autres personnages. « Il reviendra certainement, confirme l’auteur dans une interview, et je suis à un stade où je réfléchis à qui je vais le présenter en premier. Haller? Ballard? Bosch? Peut-être McEvoy? Je n’ai pas encore décidé, mais je m’amuse à imaginer toutes les possibilités. »
 « Sous les eaux d’Avalon ». De Michael Connelly. Traduit de l’anglais par Robert Pépin. Calmann-Lévy Noir, 386 p. En librairie le 11 juin 2025.
« Sous les eaux d’Avalon ». De Michael Connelly. Traduit de l’anglais par Robert Pépin. Calmann-Lévy Noir, 386 p. En librairie le 11 juin 2025.
Sur un autre livre de Michael Connelly:
https://polarspolisetcie.com/proces-a-haut-risque-pour-michael-connelly/
Se lancer dans une nouvelle aventure littéraire à 68 ans, voilà qui est plutôt rare et courageux. Après une cinquantaine de polars à succès mettant en scène ses personnages fétiches – le flic Harry Bosch, l’avocat Mickey Haller, l’inspectrice Renée Ballard et le journaliste Jack McEvoy – Michael Connelly change de décor et de héros. […]
Ecrivain aussi passionné que passionnant, Keith McCafferty a grandi dans les Appalaches. Son amour de la pêche à la mouche l’a toutefois conduit dans le Montana où il est devenu rédacteur en chef du magazine de vie au grand air Field & Stream. Le Montana sert aussi de décor et d’ancrage à ses romans, des polars mettant en scène le couple parfois explosif mais efficace formé par la shérif Martha Ettinger et son ami-amant Sean Stranahan aquarelliste, guide de pêche et détective privé à ses heures.
Sixième enquête du duo, « La rivière au cœur froid » démarre sur un fait divers tragique. Prise dans une tempête de neige, une femme meurt de froid dans la montagne, en plein mois d’avril. Pour tenter de s’en sortir, Freida avait rampé jusque dans la tanière d’un grizzli. Se sentant coupable d’avoir entraîné son épouse dans cette équipée mal préparée, son mari se suicide. Peu après, les enquêteurs découvrent dans les affaires abandonnées du couple une boîte à mouches de pêche inhabituelle. Il s’agit d' »une sorte de portefeuille en cuir, à fermeture éclair et doublé en peau de mouton » sur lequel sont estampillées à la pyrogravure les initiales EH. EH comme Ernest Hemingway, devine aussitôt le lecteur qui a lu la quatrième de couverture du livre.
Changement de ton, changement de registre. Un homme – le frère de Freida – est retrouvé mort dans une rivière. Accident ou meurtre? Le doute subsiste. Puis c’est au tour de la femme qui a découvert son cadavre d’être assassinée. Or ces deux victimes avaient, elles aussi, un lien avec Hemingway, plus particulièrement avec une mystérieuse malle de pêche qui lui appartenait et qui aurait été volée, ou perdue, lors d’un transport en train vers l’Idaho, en 1940. Une malle dont une luxueuse canne en bambou refendu s’est brusquement retrouvée sur le marché. Une malle qui, peut-être, contenait aussi un manuscrit inachevé.
Pour écrire ce roman, Keith Mc Cafferty s’est inspiré d’un fait réel. Une anecdote que lui a rapporté Jack Hemingway, le fils du célèbre écrivain. Ce livre est donc une forme d’hommage. Comme à son habitude, l’auteur puise également dans les rudes et magnifiques paysages du Montana pour nourrir, et littéralement enrober, l’enquête de la shérif Martha Ettinger et de son adjoint. Bravant les frontières, et parfois l’éthique policière, ce dernier multiplie les défis et les prises de risque. Dans sa zigzagante chasse au trésor, à la recherche d’un vieil homme un peu fou – un admirateur absolu d’Hemingway, il nous emmène crapahuter sur les eaux gelées du Froze-to-Death Lake, puis déguster un cocktail dans un bar animé de La Havane.
« La rivière au cœur froid » est un roman profus, touffu qui multiple les rebondissements, les sauts, les personnages. Il ignore la logique ordinaire, multiplie les retours en arrière et défie la hiérarchie des faits. L’enquête permet aussi à l’auteur de nous offrir une magnifique galerie de portraits haut en couleur. Et d’irrésistibles descriptions de rivières. De quoi donner des envies de pêche à la mouche même aux lecteurs les plus réfractaires à ce sport.
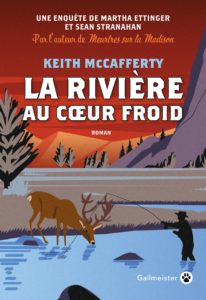 « La rivière au cœur froid ». De Keith McCafferty. Traduit de l’anglais par Marc Boulet. Gallmeister, 480 p.
« La rivière au cœur froid ». De Keith McCafferty. Traduit de l’anglais par Marc Boulet. Gallmeister, 480 p.
Sur d’autres livres de Keith McCafferty:
https://polarspolisetcie.com/les-cheminees-peuvent-etre-mortelles-avis-au-pere-noel/
https://polarspolisetcie.com/des-bisons-une-sherif-intrepide-et-une-irresistible-sirene/
Ecrivain aussi passionné que passionnant, Keith McCafferty a grandi dans les Appalaches. Son amour de la pêche à la mouche l’a toutefois conduit dans le Montana où il est devenu rédacteur en chef du magazine de vie au grand air Field & Stream. Le Montana sert aussi de décor et d’ancrage à ses romans, des […]
Auteur très prolifique – et parfois inégal – Peter May est l’homme de toutes les surprises. On l’a découvert défenseur passionné des beautés de l’île de Lewis dans sa célèbre Trilogie écossaise. On l’a retrouvé installé dans le Lot et tombé amoureux de la France dont il a pris la nationalité en 2016 et où il a situé plusieurs de ses romans policiers. Parallèlement, on a appris qu’il était aussi l’auteur d’une série remarquée de polars chinois. Et le voici, majestueux et magistral, qui revient à 73 ans à ses premières amours.
« Loch noir » se déroule en effet sur l’île de Lewis, dans les Hébrides extérieures. Subtilement émaillé de réminiscences et de flash-back, caractérisé par une météo magnifique, et donc rarissime, ce livre marque aussi le retour de Fin MacLeod, l’enquêteur de la Trilogie écossaise. L’homme a pris quelques rides. Il a quitté son job de policier pour tenter d’échapper aux terribles cauchemars qui hantent ses nuits. Il travaille désormais dans le civil, au sein d’une unité de criminalistique informatique. Ce qui, question horreur et violence, ne vaut sans doute guère mieux. Fin MacLeod forme par ailleurs avec Marsaili, son amour de jeunesse, un couple un peu triste et anémique qui brutalement va devoir se resouder pour affronter une terrible nouvelle: leur fils, Fionnlagh, enseignant, vient d’être arrêté pour meurtre.
Installé sur l’île de Lewis avec sa femme et sa petite fille, Fionnlagh est soupçonné d’avoir violé puis tué Caitlin Black, 18 ans. Elle était sa maîtresse, et son élève. Mais Fin MacLeod ne peut y croire. De retour dans l’archipel avec Marsaili, il mène discrètement l’enquête. Aussitôt, par bribes effilochées, les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse lui reviennent en tête et l’assaillent. Il y est notamment question de l’accident mortel qui l’a laissé orphelin trop tôt ainsi que des saumons volés dans un élevage avec une bande de copains. Une maraude qui s’est tragiquement terminée par la noyade de l’un d’entre eux.
Or c’est ce même élevage de saumons – agrandi et développé – qui se retrouve au cœur du roman. Nageuse hors pair, Caitlin, la jeune morte, collaborait étroitement avec un activiste anti-pisciculture. Leur but: dénoncer les conditions scandaleuses dans lesquelles meurent par dizaines de milliers les saumons, attaqués par les méduses et les poux. Des descriptions et des détails répugnants que l’on déconseille à tout gourmet amateur de salmonidés!
Visiblement bien documenté, Peter Maye intègre aussi très habilement dans son roman la vision dantesque de douzaines de baleines venues s’échouer sur la plage. Et qu’on ne parviendra pas à sauver. Un épisode qui aura des retombées inattendues sur le dénouement du récit. Tout à la fois lyrique et militant, « Loch noir » participe donc d’une architecture complexe. Pour mieux marier présent et passé, Peter May déploie son intrigue comme un double filet dont les mailles parfois s’ajustent, révélant au grand jour des vérités longtemps enfouies. Une manière habile et subtile de tenir le lecteur en haleine. Du grand art!
 « Loch noir ». De Peter May. Traduit de l’anglais par Ariane Bataille. Rouergue noir, 368 p.
« Loch noir ». De Peter May. Traduit de l’anglais par Ariane Bataille. Rouergue noir, 368 p.
Auteur très prolifique – et parfois inégal – Peter May est l’homme de toutes les surprises. On l’a découvert défenseur passionné des beautés de l’île de Lewis dans sa célèbre Trilogie écossaise. On l’a retrouvé installé dans le Lot et tombé amoureux de la France dont il a pris la nationalité en 2016 et où […]
Ce livre est une suite. Il s’agit du deuxième volet d’une trilogie consacrée à la guerre du Liban par le Français Frédéric Paulin. L’auteur ne s’y embarrasse ni de résumé, ni de flash-back. Il est donc préférable d’avoir lu le premier tome (« Nul ennemi comme un frère ») avant d’aborder « Rares ceux qui échappèrent à la guerre ». Un « effort » largement récompensé! Mêlant habilement faits historiques et fiction, ce roman noir esquisse par petites touches précises et subtiles une réalité infiniment complexe et mouvante manipulée, et souvent tronquée, par les intérêts divergents des différentes parties en présence, communautés chrétienne, druze, chiite et sunnite notamment.
« Rares ceux qui échappèrent à la guerre » démarre en octobre 1983. En plein drame. Un attentat, à Beyrouth, vient de faire une soixantaine de victimes françaises. Des parachutistes. La France se doit de réagir. Un ping-pong tragique alors s’engage. La guerre s’invite brutalement dans les consciences jusqu’en métropole. Aux attentats, succèdent les enlèvements, dont celui du journaliste Jean-Paul Kauffmann. S’y ajoutent, en France même, les assassinats et les interventions violentes revendiquées par le groupe terroriste Action directe. Et le roman s’achève, le 17 septembre 1986, avec une attaque meurtrière. Une bombe, placée dans une poubelle, explose rue de Rennes, juste devant le magasin Tati.
« Rares ceux qui échappèrent à la guerre » est minutieusement documenté. Mais son récit se nourrit aussi de fiction. On y retrouve plusieurs personnages du précédent roman, dont le commandant Christian Dixneuf de la DGSE, un homme aussi lucide qu’intrépide. Entré en disgrâce et renvoyé en France, il finit par démissionner, mais n’abandonne pas la lutte. Son statut d’agent secret permet à l’auteur, Frédéric Paulin, de faire bénéficier son lecteur d’informations privilégiées dont bien peu disposaient dans les années 1980. Désabusé, Dixneuf se désespère toutefois face à cette guerre qui n’en finit pas et semble se reproduire elle-même, « comme si les militaires et les miliciens avaient des intérêts à la perpétuation du conflit ».
 « Rares ceux qui échappèrent à la guerre (1983-1986) ». De Frédéric Paulin. Agullo Editions, coll. Agullo Noir, 416 p. « Que s’obscurcissent le soleil et la lumière », le troisième volume de la trilogie, sortira le 11 septembre 2025.
« Rares ceux qui échappèrent à la guerre (1983-1986) ». De Frédéric Paulin. Agullo Editions, coll. Agullo Noir, 416 p. « Que s’obscurcissent le soleil et la lumière », le troisième volume de la trilogie, sortira le 11 septembre 2025.
Sur « Nul ennemi comme un frère », le premier volet sur la guerre du Liban, lire: https://polarspolisetcie.com/1975-le-liban-basculait-dans-lhorreur/
Ce livre est une suite. Il s’agit du deuxième volet d’une trilogie consacrée à la guerre du Liban par le Français Frédéric Paulin. L’auteur ne s’y embarrasse ni de résumé, ni de flash-back. Il est donc préférable d’avoir lu le premier tome (« Nul ennemi comme un frère ») avant d’aborder « Rares ceux qui échappèrent à la […]
A propos de ce blog

Scènes et mises en scène: le roman policier, l’architecture et la ville, le théâtre. Passionnée de roman policier, Mireille Descombes est journaliste culturelle indépendante, critique d’art, d’architecture et de théâtre.
Photo: Lara Schütz





